Pourquoi parler d’« interfaces G2–G3–G4 » ?
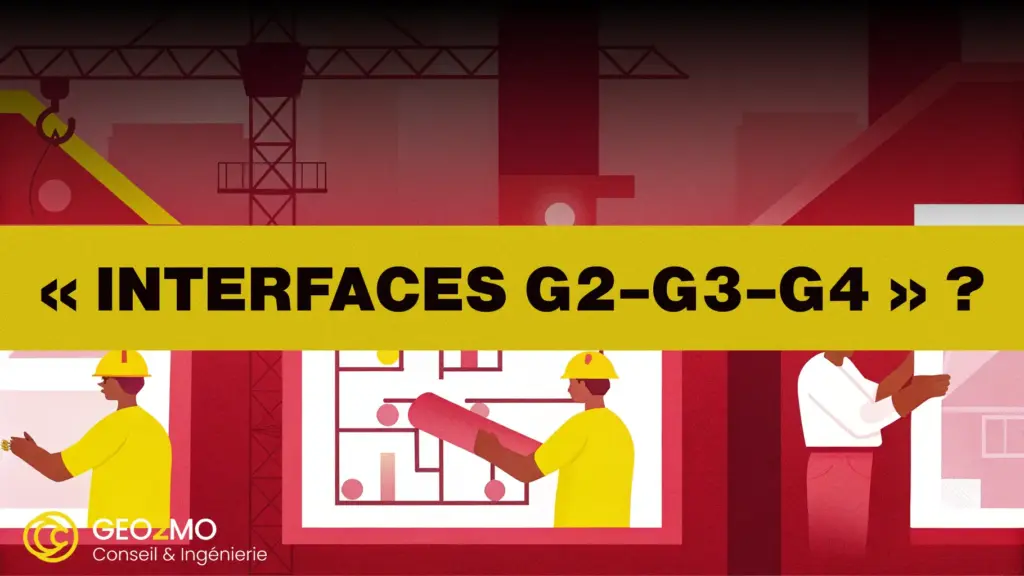
La norme NF P94-500 (2013) impose un enchaînement séquentiel des missions géotechniques G1, G2, G3/G4, synchronisé avec les phases du projet.
Autrement dit, chaque étape de conception puis de réalisation doit intégrer l’ingénierie géotechnique : le maître d’ouvrage (MOA) doit associer le BE géotechnique à toutes les phases du projet et veiller à la coordination des missions G1→G2→G3/G4.
En pratique, G2 correspond à l’étude géotechnique de conception (avant-projet et projet), G3 à l’étude et suivi géotechniques d’exécution (réalisés par l’entreprise), et G4 à la supervision géotechnique (contrôle externe) pour le compte du MOA / MOE.
Cette chaîne obligatoirement intégrée vise à maîtriser les risques géotechniques du projet : le respect de l’ordre G2→G3→G4 évite les zones d’ombre dans la responsabilité géotechnique et sécurise les décisions en chantier.
Rôles & responsabilités : qui fait quoi ? (RACI géotechnique)

- MOA (Maître d’Ouvrage) : décide du projet et des arbitrages globaux (niveau de risque accepté, variantes, financement), et mandate les études géotechniques. Il veille à ce que les missions G1, G2, G3, G4 soient bien confiées et synchronisées avec le planning MOE.
En pratique, le MOA valide le modèle G2 final, mandate le BE pour le G4 (avis indépendant) et donne les orientations stratégiques (budget, calendrier). - MOE (Maîtrise d’Œuvre) : organise et coordonne les études et travaux (DET/VISA). Il assure le visa technique et le suivi contractuel du projet. Le MOE reçoit les livrables G2/G3/G4, les intègre dans les études d’exécution (cahier des charges, DOE), et décide des ajustements techniques (sur avis G4) avant signature ou levée des réserves.
- Entreprise (entrepreneur / constructeur) : conduit la mission G3 d’étude et suivi d’exécution géotechnique. La G3 est explicitement confiée à l’entreprise réalisant les travaux géotechniques. Cela signifie que l’entreprise fournit sur le chantier le plan d’essais, les contrôles (auscultations) et les fiches d’écart associées, sous la responsabilité du BE coordinateur. L’entreprise informe le MOE/MOA et le BE géotech de l’avancement et des écarts constatés.
- Bureau d’Études géotechniques (BE G2 / BE G4) : réalise la mission G2 pour le compte du MOA (en lien avec le MOE) et élabore le modèle géotechnique initial. Les données produites en G2 (stratigraphie, paramètres, ZIG, hypothèses de calcul) sont capitales pour la suite. Le même BE réalise souvent également la mission G4 en fin de projet (par souci de continuité du modèle), bien que la G4 soit mandatée par le MOA. En pratique, la G3 est décrite comme la « continuité » de l’étude de conception G2, ce qui valorise le fait de maintenir la même équipe sur G2 et G4 pour préserver la cohérence du modèle. Un tableau RACI typique ferait par exemple du BE G2 le responsable du modèle initial, du BE G4 le responsable du contrôle géotechnique, du MOA le décideur final et du MOE le coordinateur (VISA) des actions.
Exemple de tâches clés (modèle géotechnique, plan d’essais, gestion des écarts, validations finales, DOE/DIUO) : en synthèse on peut penser un RACI où le MOA est décideur/autorité (A) sur le modèle et la supervision G4, le MOE est responsable (R) du planning, du VISA et de la coordination, l’entreprise est responsable (R) du G3 et exécutrice, le BE G2 est responsable (R) de l’étude de conception (modèle, hypothèses), et le BE G4 responsable (R) de l’étude de contrôle externe. Note pratique : il est généralement conseillé de confier G2 et G4 au même bureau d’études géotechnique, afin d’assurer la continuité du modèle et une levée rapide des points durs en chantier.
Interface G2 → G3 : comment le chantier ré-interroge le modèle
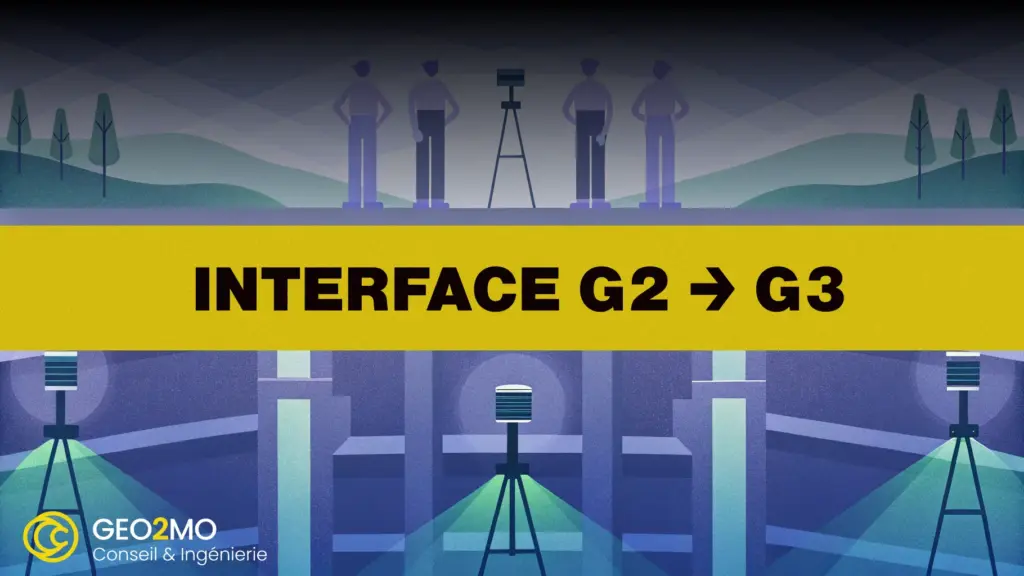
À l’arrivée sur chantier, le modèle géotechnique issu de la mission G2 est l’outil de référence.
Ce pack de transfert G2→G3 comprend notamment les hypothèses clés du modèle (stratigraphie, valeurs de paramètres géotechniques issues des études pressiométriques et laboratoires), la zone d’influence géotechnique (ZIG), le niveau de nappe, ainsi que les aléas résiduels et critères d’acceptation prévus.
Le BE G2 livre donc des hypothèses et principes de calcul (par exemple enveloppes de réactions, pentes de talus, capacité portante) qui seront testés en phase G3.
La mission G3 élabore un programme d’études d’exécution basé sur ces données : on définit un plan d’essais (convenance, géophysique, in situ et en labo) et un cahier des charges d’auscultation pour le chantier.
On y intègre des boucles « mesure-réaction » avec seuils prédéfinis : par exemple, des inclinomètres ou capteurs posés en amont serviront à contrôler le tassement et la stabilité. Si des valeurs mesurées dépassent les seuils déterminés, des actions conservatoires ou correctives sont déclenchées.
En particulier, « si dépassement(s) de valeurs seuils, [il faut] faire appliquer les dispositions conservatoires nécessaires ».
Ces procédures assurent que toute dérive par rapport au modèle initial est détectée et traitée.
Quand réviser le modèle G2 en cours de chantier ?
Plusieurs situations « déclencheurs » imposent de revenir sur le modèle de G2 :
- Changement du mode de fondation ou des niveaux d’ancrage par rapport à ce qui était prévu (par exemple, passage de semelles filantes à des micropieux partiels).
- Découverte d’une nappe phréatique beaucoup plus haute que prévue.
- Présence de sols plus compressibles (argiles gonflantes, tourbe) ou de vestiges/obstacles (pierres, structures anciennes) non anticipés.
- Mesures terrain qui montrent des résistances au sol ou des tassements bien différents des hypothèses G2.
Interface G3 → G4 (contrôle externe & LCS)
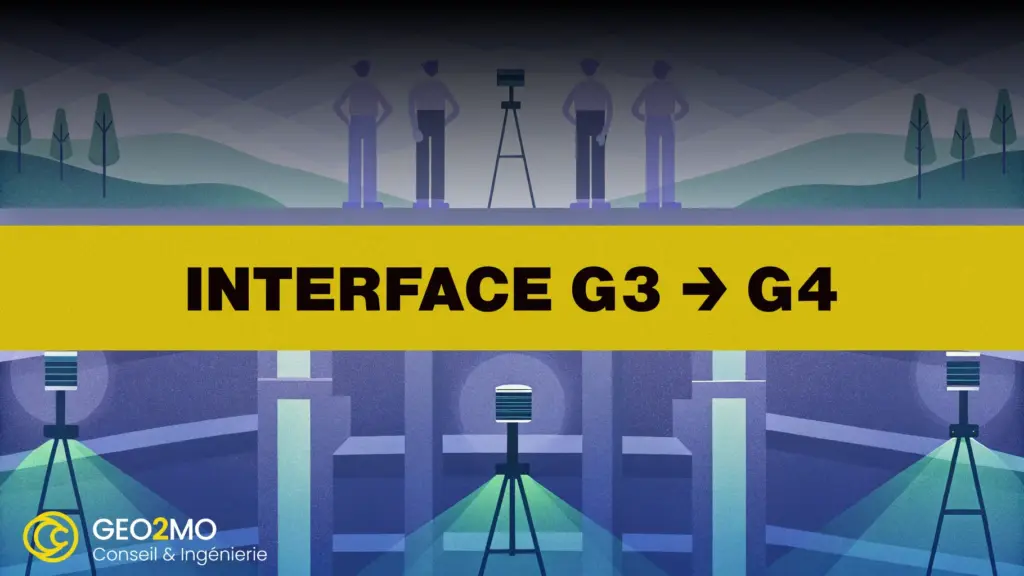
La mission G4 a pour objet la supervision géotechnique d’exécution pour le compte du MOA (souvent via son mandataire) en collaboration avec le MOE. Elle vérifie, sur le terrain, que le modèle et les recommandations G2–G3 sont bien respectés. Concrètement, le BE en charge de G4 “doit vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans l’étude d’exécution”.
La G4 comprend deux phases : la supervision de l’étude d’exécution (vérification des notes de calcul, hypothèses et plans fournis en G3, avis sur les méthodes et adaptations proposées par l’entreprise) et la supervision du suivi d’exécution (visites sur le chantier pour valider le contexte géotechnique réel et le comportement observé de l’ouvrage, ainsi que les optimisations proposées).
L’étude de sol G4 est « à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire » et a pour rôle principal de maîtriser les risques géotechniques identifiés et d’assurer que les ouvrages respectent les préconisations établies.
Les données d’entrée G4 sont toutes les pièces issues de G3 : notes de calcul, plans d’exécution, résultats de contrôles (auscultations, mesures) et fiches d’écart remontées par l’entreprise, ainsi que les propositions d’adaptations (solutions de reprise, variantes) que l’entreprise envisage.
Le géotechnicien G4 analyse ces données pour juger de la cohérence entre le terrain réel et le modèle G2/G3.
Cette mission se couple au contrôle technique du projet. Le contrôleur technique (mission L/S) vérifie la conformité structurelle globale et peut notamment conditionner le démarrage des forages géotechniques par une « levée de la clause de sécurité » (LCS) spécifique aux ouvrages géotechniques.
Les avis G4 fournissent des éléments de preuve technique pour lever cette clause : par exemple, le BE G4 valide que les conditions réelles correspondent aux hypothèses ou recommande des mesures compensatoires.
À la différence du visa MOE (qui atteste formellement le respect des pièces contractuelles), l’avis G4 est un avis technique géotechnique détaillé. Il porte notamment sur les adaptations appliquées en phase travaux et permet de compiler le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et Dossier d’Interventions Ultérieures (DIUO) sur l’aspect géotechnique.
Flux d’information & traçabilité : du modèle initial au DOE
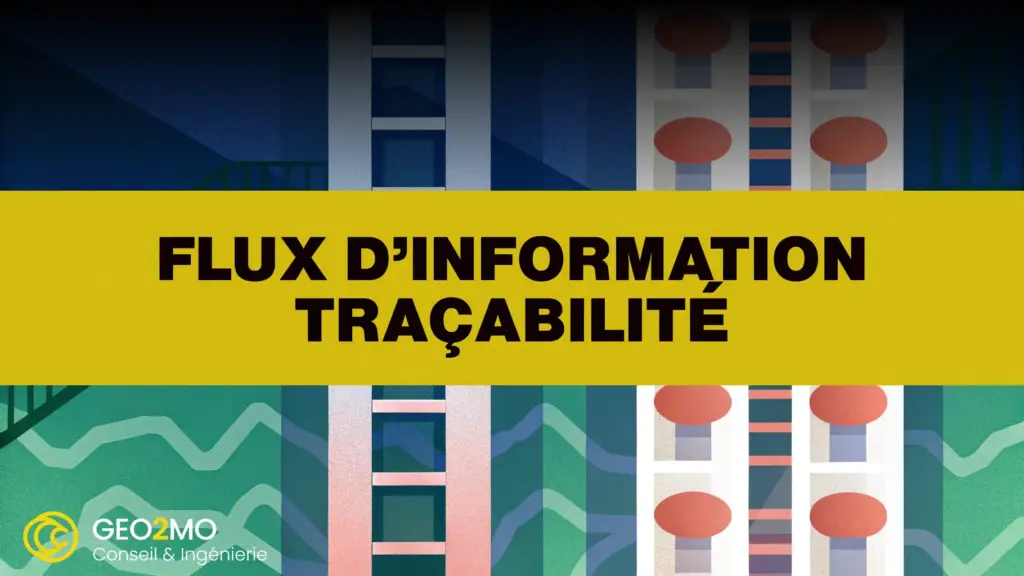
Le schéma d’information typique peut se représenter ainsi : les hypothèses et modèles G2 initiaux alimentent le plan d’essais G3, qui définit les contrôles et seuils à respecter. Pendant le chantier, les mesures et écarts sont consignés (fiches d’écart, journal de chantier). Si nécessaire, le modèle géotechnique est mis à jour en temps réel (données actualisées).
Le BE G4 émet alors son avis sur le modèle révisé avant toute modification majeure en chantier. Sur la base de ces éléments, le chantier prend ses décisions (go/no-go) à chaque étape. Enfin, tous les documents et validations du chantier sont versés dans le DOE et DIUO finaux.
Plusieurs outils assurent la traçabilité : des fiches d’écart géotechnique (pour consigner les anomalies terrain), un tableau de suivi des mesures et seuils, une matrice de risques mise à jour en continu, etc. Chaque document important (modèle, note de calcul, rapport G3/G4) est horodaté et visé (MOE, BE, MOA) pour garantir la traçabilité des versions.
Au final, la documentation du DOE atteste que le projet a été conduit conformément au modèle géotechnique (ou qu’il a été adapté en sécurité).
« Gates » décisionnels : où se parlent MOA, MOE, Entreprise, BE ?
Plusieurs points d’arrêt clés jalonnent le projet géotechnique :
- Démarrage des terrassements : avant d’ouvrir la fouille, la G3 définit le plan de sondages, visa MOE et avis G4 initiaux doivent être validés pour garantir la stabilité de l’excavation.
- Début des fondations/soutènements : la méthode envisagée (micropieux, pieux forés, semelles spéciales) doit être validée par le BE géotech G4 (conformément à l’étude G2/G3). On ne lance les travaux que lorsque l’avis G4 est reçu sur les variantes éventuellement proposées.
- Phases sensibles (dévoiements de réseaux, installation de tirants, injections, remblaiements) : des réunions de chantier décident du passage à l’étape suivante. Par exemple, si un inclinomètre installé en phase précédente approche son seuil critique, l’équipe projet (MOA/MOE/BE/Entreprise) se réunit pour ajuster les tirs d’ancrage ou le séquençage de terrassement. Toute reprise de procédure (passage d’une phase à l’autre) est conditionnée aux données G3 acquises et à l’accord formel G4.
Une check-list de communication est souvent établie : qui diffuse quoi, quand et à qui.
Par exemple, après chaque réunion de chantier, un compte-rendu centralise les décisions géotechniques (plans modifiés, seuils mis à jour, réserves MOE levées).
Le BE géotech distribue ses avis écrits (plutôt que par mail oral), le MOE inscrit les modifications dans le plan d’exécution et vise les documents.
Le MOA recevra en fin de chantier le DOE géotechnique final, visé par le BE G4, pour pouvoir signer la réception des ouvrages.
Mini-cas pédagogiques (3 scénarios)
- Fondations superficielles → micropieux partiels : l’étude G2 avait prévu des semelles filantes, mais la G3 met en évidence une portance insuffisante et des tassements plus importants que prévu. Le BE réajuste les paramètres géotechniques (sol plus mou) et propose de piloter la modification partielle en optant pour des micropieux sous certaines zones. Le BE G4 donne son avis favorable sur cette adaptation (assurant la continuité du modèle) et la conditionne à des contrôles renforcés.
- Soutènement : lors du montage des parois berlinoises, les inclinocomètres traduisent un dévers supérieur au seuil d’alerte fixé en G2/G3. L’équipe projette alors d’ajuster le phasage de creusement et d’ajouter deux ancrages transversaux. Le BE G4 intervient pour valider ces mesures correctives avant exécution, en vérifiant que le modèle révisé (prise en compte de la moindre raideur du sol) garantit la stabilité finale.
- Nappe plus haute que prévu : au démarrage des fondations profondes, on rencontre la nappe phréatique à un niveau supérieur au prévisionnel G2. Le BE propose de mettre en place un drainage provisoire du fouille et d’augmenter les matériaux drainants sous radier. Le modèle géotechnique est alors mis à jour (ajout de cette nappe), et le planning/ coût du chantier sont réévalués. Le BE G4 vérifie techniquement ces mesures (colmatage du radier, puis filtration de la nappe) et délivre un avis de reprise de l’ouvrage en toute sécurité.
Livrables & preuves par phase
- G2 – Étude de conception : le BE fournit le modèle géotechnique initial (stratigraphie, carte géologique préliminaire), la ZIG, les hypothèses de calcul (valeurs de paramètres), des principes de construction envisagés (fondations, soutènements), ainsi qu’une ébauche dimensionnelle des ouvrages. Il établit des enveloppes de calcul (variations plausibles des paramètres) et des cartes d’aléas géotechniques. Ces livrables figurent dans le rapport G2 (AVP/PRO). Par exemple, la G2 définit la ZIG, les hypothèses géotechniques et les principes constructifs envisageables.
- G3 – Étude d’exécution et suivi : le BE produit le dossier d’exécution géotechnique (plans et notes techniques d’exécution détaillés), le plan d’essais sur site et en laboratoire. Pendant le chantier, il rédige les fiches d’écart pour chaque non-conformité relevée et les procès-verbaux de suivi. En fin de travaux, la G3 génère plusieurs documents clés : notamment les plans d’exécution finalisés, les notes de calcul révisées et le DOE géotechnique (Dossier des Ouvrages Exécutés) avec le DIUO associé.
- G4 – Supervision d’exécution : le BE en charge de G4 rend des avis géotechniques écrits sur l’étude d’exécution et sur chaque variante soumise par l’entreprise. Il délivre des procès-verbaux de supervision géotechnique lors de ses visites de chantier. Enfin, l’apport de G4 se traduit par sa contribution au DOE/DIUO final : en validant la prestation géotechnique du chantier, il permet d’inscrire ses observations techniques dans le DOE et dans le Dossier d’Interventions Ultérieures.
Bonnes pratiques de coordination (retours d’expérience)
- Synchroniser l’ingénierie et les phases MOE : la norme souligne que missions MOE (maquette du projet) et missions géotech doivent être parfaitement synchronisées. Il est recommandé d’adapter chaque mission au retour de la précédente. Par exemple, si la G2 révèle des incertitudes majeures, augmenter le nombre de sondages pour la G3, etc. Ce travail itératif « boucle » est inscrit dans la NF P94-500 (on revoit si besoin G2 après G3 en cas de découvertes imprévues).
- Continuité d’équipe : désigner le même BE ou les mêmes ingénieurs pour G2 et G4 favorise la cohérence du modèle géotechnique. La G3 étant elle-même « la continuité » de la G2, garder l’équipe permet de réduire les malentendus et gagner en réactivité.
- Traçabilité rigoureuse : formaliser toutes les décisions et versions. Chaque note G2/G3/G4 doit être visée par le MOE et le MOA (ou mandataire) à chaque phase, et archivées. Les fiches d’écart géotechniques doivent faire référence à la version du modèle concernée. Un tableau de bord de suivi (avec indicateurs et seuils) aide à relier chaque anomalie mesurée à une décision prise.
- Anticiper les assurances et le contrôle technique : informer en amont l’assureur géotechnique et le contrôleur technique du déroulé G2–G3–G4. Prévoir contractuellement les prestations géotech (G4 en particulier) et les lier aux clauses de sécurité du CT. Un document de synthèse (par ex. PPVR – Plan de Prévention et de Visite Géotechniques) peut être joint au DOE pour expliciter le circuit décisionnel suivi.
Conclusion
Une chaîne G2–G3–G4 bien coordonnée est un gage de succès pour le projet : elle réduit considérablement les aléas (imprévus de terrain), accélère les décisions en chantier et permet de mieux tenir coûts et délais. Chaque acteur sait alors qui fait quoi, à quel moment, avec quel seuil de tolérance.
Besoin d’expertise ?
GEO2MO propose un audit de coordination géotechnique : revue du modèle G2 initial, vérification du protocole G3, mise en place d’un plan de supervision G4, et établissement de « gates » décisionnels formalisés (RACI projet).
Contactez-nous pour garantir la cohérence de votre chaîne G2→G3→G4.
FAQ :
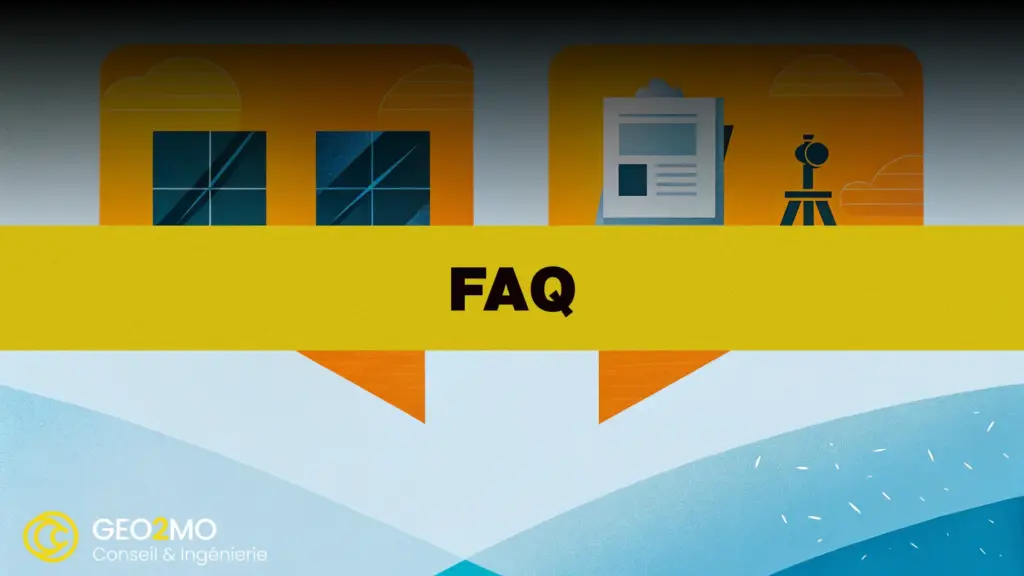
- Quand revoit-on officiellement le modèle G2 en phase travaux ?
En principe, le modèle G2 n’est révisé que si les conditions réelles se révèlent significativement différentes des hypothèses (cf. cas ci-dessus). Une réunion formelle est souvent organisée après la phase préparatoire (après sondages G3 initiaux ou terrassements préliminaires) : on y compare les résultats terrain aux hypothèses G2 pour décider si un « re-calage » du modèle est nécessaire. Si oui, le BE propose un avenant de mission pour mise à jour du rapport G2. En tout état de cause, toute révision est consignée dans le DOE comme partie intégrante du « suivi géotechnique ».
- G3 et G4 peuvent-elles être menées par le même BE que la G2 ? Avantages/limites.
Oui, c’est fréquent de confier G2 et G4 au même bureau d’études (ou à la même équipe) – c’est ce que recommandent plusieurs retours d’expérience.
L’avantage est la continuité du modèle géotechnique : le BE qui a élaboré le modèle initial connaît déjà ses hypothèses et sait où insister en suivi. L’inconvénient potentiel est la question d’indépendance : le BE a conçu le modèle, doit maintenant le contrôler. Pour limiter ce biais, le BE G4 agit sous la responsabilité du MOA et en lien avec le MOE, avec des procédures claires (par exemple, avis G4 formalisé indépendant du BE G3).
- Quelle différence entre le VISA MOE et l’avis G4 ?
Le visa MOE est une validation administrative/contractuelle : la maîtrise d’œuvre vérifie que les études d’exécution (G3) respectent le cahier des charges et règle le contrat, et elle appose son visa pour donner le feu vert technique. L’avis G4 est un avis géotechnique technique rendu au MOA : il évalue la validité des hypothèses géotechniques, des méthodes d’exécution et des résultats terrain. Autrement dit, le visa MOE confirme la conformité des pièces (plans, notes) du point de vue du contrat, tandis que l’avis G4 fournit la preuve technique de conformité géotechnique en chantier (nécessaire à la levée de la clause de sécurité). Ce sont deux niveaux de contrôle complémentaires.


