Maîtriser les risques géotechniques en temps réel lors d’un chantier, c’est possible grâce à une instrumentation adaptée.
L’approche observationnelle (Eurocode 7) encourage à suivre le comportement du sol et des ouvrages pendant les travaux pour ajuster au besoin la conception et les méthodes en cours de route.
Instrumenter en phase G3 (étude et suivi géotechnique d’exécution) permet ainsi de sécuriser le projet, éviter des sinistres coûteux et tenir les délais.
Dans cet article, nous allons bâtir un Plan de Contrôle Géotechnique (PCG) complet, avec des seuils d’alerte actionnables et tous les livrables nécessaires pour un suivi efficace.
À la fin de la lecture, vous disposerez d’un PCG G3 prêt à déployer : grille de fréquences de mesure (Green/Amber/Red), seuils d’alerte tricolores et trames de rapports clés inclus.
Cadre normatif & responsabilités (Mission G3)
En France, la mission G3 est définie par la norme NF P 94-500 (2013) comme l’étude et le suivi géotechniques d’exécution.
Concrètement, le bureau d’études géotechnique en charge de la G3 (souvent prestataire de l’entreprise de travaux) valide les hypothèses de la G2 (conception), réalise les notes de calcul d’exécution détaillées et précise les méthodes et conditions d’exécution (phasage, contrôles, auscultations) pour réduire les risques géotechniques.
La G3 se déroule en deux temps : phase étude (reprendre et affiner la conception) et phase suivi (surveiller les travaux).
En parallèle, la mission G4 – supervision géotechnique d’exécution – est assurée pour le maître d’ouvrage (ou sa MOE) : elle supervise la G3 en définissant notamment le programme d’auscultation et les valeurs seuils d’alerte, et en analysant périodiquement les résultats des mesures pour vérifier la conformité aux objectifs du projet.
Autrement dit, G3 (côté entreprise) implémente l’instrumentation et G4 (côté maîtrise d’ouvrage) valide et suit les résultats.
La répartition des responsabilités doit être sans équivoque. Le maître d’ouvrage s’assure de la mise en place des missions géotechniques (G4 si nécessaire) et alloue les moyens pour la surveillance.
Le maître d’œuvre coordonne le plan de contrôle avec les autres lots du chantier. L’entreprise réalise l’installation des capteurs et les relevés G3 conformément au plan de contrôle.
Le bureau d’études géotechnique (mandaté en G3 par l’entreprise ou le MOA selon les cas) conçoit le PCG, interprète les mesures et alerte en cas de dérive. Un schéma de responsabilités RACI peut clarifier qui conçoit, qui installe, qui relève, qui décide à chaque étape du suivi .
Sur le plan normatif européen, l’Eurocode 7 (EN 1997-1, §2.7) consacre l’approche observationnelle. Celle-ci impose, avant les travaux, d’établir des valeurs limites admissibles et un programme de surveillance capable de détecter suffisamment tôt tout écart par rapport aux prévisions, afin de permettre des mesures correctives en temps utile.
Pendant les travaux, en cas d’événement imprévu, les méthodes, l’étendue et la fréquence des mesures doivent être réexaminées pour s’adapter à la situation.
L’Eurocode 7 exige également que le niveau de surveillance mis en œuvre soit cohérent avec les risques identifiés et les facteurs de sécurité adoptés .
Enfin, la qualité du suivi en chantier s’intègre dans le dispositif global PAQ/PQ (Plan Assurance Qualité / Plan Qualité).
D’après le guide d’application du CCTG Fascicule 69 (travaux souterrains, CETU), le Plan Qualité de l’entreprise doit inclure l’organisation et les procédures de contrôle d’exécution, notamment la pose des instruments et les mesures de surveillance.
Ce Plan Qualité est un document contractuel préparé en phase de préparation des travaux, qui spécifie l’organisation, les procédures d’exécution et de contrôle, ainsi que les ressources que l’entreprise met en œuvre pour assurer la qualité requise.
Le CCTP du marché doit exiger ces dispositions, avec identification des points critiques (étapes nécessitant une information préalable de la MOE pour suivi) et des points d’arrêt (seuils au-delà desquels les travaux ne peuvent continuer sans accord formel).
Ainsi, le cadre normatif et contractuel fournit une base solide au PCG G3, en cadrant responsabilités, méthodologie observationnelle et exigence de qualité du suivi.
Objectifs d’un Plan de Contrôle Géotechnique (PCG) en G3
Le Plan de Contrôle Géotechnique en mission G3 a pour rôle de démontrer que tout se passe comme prévu… ou d’identifier rapidement le contraire. Ses objectifs principaux sont :
- Conformité aux hypothèses de conception (G2) : vérifier que le comportement réel du sol et des structures reste dans la plage anticipée par les notes de calcul. Par exemple, s’assurer qu’un soutènement ne flue pas au-delà des déplacements calculés, ou que le niveau d’eau reste sous contrôle. Le PCG doit apporter la preuve de cette conformité ou, dans le cas contraire, fournir l’alerte nécessaire pour reviser la conception.
- Sécurité des tiers et avoisinants : surveiller les effets des travaux sur l’environnement proche (bâtiments mitoyens, voiries, réseaux enterrés). L’instrumentation doit permettre de prévenir tout mouvement ou tassement dommageable et de protéger les riverains.
- Performance des ouvrages provisoires et définitifs : contrôler que les ouvrages géotechniques temporaires (parois, butons, palplanches) et définitifs (fondations, remblais, digues…) remplissent leur fonction en toute sécurité pendant le chantier et après.
Le périmètre du PCG doit couvrir l’ensemble des zones et ouvrages à risque identifiés en G2 : cela inclut les ouvrages géotechniques du projet (en phase temporaire et finale) et leur interaction avec le site environnant (batiments voisins, nappe phréatique, talus naturels, etc.).
Chaque phase du chantier doit être prise en compte (excavation, soutènement, remblaiement, mise en charge, etc.), car les moments critiques peuvent varier selon le phasage.
Le PCG précise également les modalités d’intervention et de décision à chaque étape, souvent sous forme de matrice RACI.
Par exemple : qui est responsable de la conception du plan d’auscultation (généralement le géotechnicien G3), qui est exécutant des mesures sur le terrain (souvent l’entreprise ou un sous-traitant spécialisé), qui doit être consulté pour l’interprétation (le concepteur G2, l’ingénieur d’exécution, etc.) et qui doit être informé en temps réel (MOE, MOA) en cas d’alerte.
Le PCG fixe des points d’arrêt obligatoires : par exemple, ne pas bétonner une paroi moulée tant que l’inclinaison mesurée n’a pas été validée dans la tolérance.
Ces points d’arrêt et points critiques de contrôle sont définis par la G3 et validés par le maître d’ouvrage avant le démarrage des travaux , assurant qu’aucune étape à risque ne se franchit sans feu vert géotechnique.
En résumé, le PCG G3 est la feuille de route du suivi géotechnique d’un chantier : il doit prouver la conformité du réel au prévisionnel, garantir la sécurité de tous, et prévoir qui fait quoi pour réagir vite en cas d’écart. Nous allons voir comment bien choisir les capteurs, organiser les mesures et définir ces fameuses alertes.
Choisir les capteurs : quoi mesurer, où, comment ?
Un bon plan d’instrumentation commence par le choix judicieux des capteurs géotechniques en fonction des paramètres à surveiller.
Voici les principaux instruments de suivi en géotechnique, et comment les déployer efficacement en G3 :
- Inclinomètres – Ils mesurent les déformations latérales du sol ou des ouvrages (parois, écrans) en profondeur. Un inclinomètre consiste en un tube-casing vertical scellé dans le sol, à l’intérieur duquel on passe soit une sonde mobile manuelle à intervalles réguliers (typiquement tous les 0,5 m), soit des capteurs « in-place » fixes (chaîne de clinomètres automatisés).
On en déduit le profil des déplacements horizontaux dans le sol.
Le choix manuel vs automatique dépend de la criticité du suivi : la sonde manuelle offre une haute résolution mais en lecture intermittente (par ex. quotidienne ou hebdomadaire), tandis qu’une chaîne in-place permet un suivi en continu (plusieurs mesures par heure si nécessaire). Les inclinomètres doivent idéalement descendre sous la zone de glissement potentielle (ou la base de l’ouvrage) pour avoir un point fixe de référence. La norme ISO 18674-3 (2017) encadre ces mesures de déplacement le long d’une verticale .
Elle indique que les inclinomètres s’appliquent notamment au suivi en phase de construction et à la vérification des ouvrages via l’approche observationnelle.
En termes de précision, un bon inclinomètre détecte des mouvements de l’ordre du millimètre.
Points d’attention à l’installation : un tube bien vertical et solidement ancré, un bon scellement dans le forage (coulis de ciment) sauf sur la zone glissante où un tubage débrayable peut être prévu, et une protection en tête (regard) pour éviter toute détérioration pendant le chantier. - Piézomètres – Ils mesurent la pression interstitielle de l’eau dans le sol, ou plus simplement le niveau piézométrique de la nappe. C’est indispensable pour suivre l’effet des excavations sur la nappe, contrôler un rabattement de nappe, ou détecter des surpressions dans un remblai ou derrière un écran étanche.
Il existe deux grandes catégories : les systèmes ouverts (piezomètres dits Casagrande ou standpipe) où une colonne d’eau dans un tube perforé équilibre la pression du sol, lue manuellement à la sonde ou par capteur de niveau ; et les systèmes fermés à cellule de mesure (souvent des capteurs de pression vibrants ou pneumatiques reliés par câble), qui convertissent la pression d’eau en signal électrique.
Les piezomètres ouverts conviennent aux sols perméables et aux variations lentes (temps de réponse plus long), tandis que les piezomètres fermés permettent de capter des fluctuations rapides dans des sols peu perméables, avec un suivi en continu. La norme ISO 18674-4 (2020) donne les règles d’installation et mesure par piezomètres , en distinguant bien les systèmes ouverts vs fermés, le choix des filtres (granulométrie adaptée pour empêcher le colmatage par les sédiments ) et les méthodes de scellement.
Un progrès notable est la reconnaissance du scellement “fully grouted” (gaine entièrement injectée) comme méthode normative d’installation : on peut maintenant noyer un piézomètre vibrant dans un coulis bentonite-ciment approprié, ce qui facilite la mise en place de multiples capteurs à différentes profondeurs dans un seul forage.
Points clés d’installation : bien saturer le capteur et le filtre avant pose (éviter les bulles d’air), effectuer un scellement étanche entre les niveaux d’aquifères différents, protéger la tête de puits, et prévoir un essai de réponse (par ex. pompage ou charge d’eau) pour vérifier que le piezomètre réagit correctement aux variations de niveau. - Suivi de tassements – Les tassements verticaux du sol ou des structures sont suivis par différentes techniques de nivellement. En surface, on utilise des repères altimétriques (plots béton, repères fixés sur des bâtiments, qu’on relève périodiquement au niveau optique ou laser). Sur les ouvrages, on peut poser des cibles ou prismes réfléchissants surveillés par tachéomètre automatique (station totale robotisée). Pour mesurer la consolidation d’un remblai ou le tassement sous une fondation, on recourt classiquement aux plaques de tassement (disque métallique posé sur le sol, relié à une mire accessible que l’on nivelle) ou à des extensomètres profonds (à barre, à câble ou magnétiques) pour distinguer les mouvements à différentes profondeurs.
Ces instruments sont décrits dans les guides spécialisés (Dunnicliff, USACE…) et doivent être choisis selon le cas d’usage : par exemple, une plaque de tassement est idéale sous un remblai sur sol compressible, alors qu’un prisme optique conviendra mieux pour surveiller en continu le fléchissement d’un bâtiment mitoyen d’une excavation.
Précautions : assurer un point de référence stable hors zone influencée pour tous les nivellements (bornes de référence), protéger les repères sur chantier (borne dans un regard ou sur un poteau), et dans le cas des extensomètres, bien enregistrer la cote initiale de chaque cible interne. La précision visée est de l’ordre de ±1 mm en altimétrie.
En synthèse, le PCG G3 doit définir quoi mesurer et comment : déplacements horizontaux (inclinomètres), pressions d’eau (piézomètres), déplacements verticaux (nivellements/extensomètres), éventuellement d’autres paramètres selon le projet (par ex. déformations de structure via jauges de contrainte, efforts dans les ancrages, vibrations sismiques, etc.).
Une fois les capteurs choisis et implantés aux endroits stratégiques (points singuliers de l’ouvrage, zones à risque identifiées en G2), il faut organiser la stratégie de mesure dans le temps.
Stratégie de mesure par phase de chantier
La surveillance géotechnique doit s’adapter au rythme du chantier. On distingue généralement trois périodes clés :
- Avant le début des travaux : Il est crucial d’établir un état initial stable pour chaque instrument.
On recommande de réaliser au moins 2 à 3 séries de mesures de référence espacées dans le temps (quelques jours à quelques semaines) avant tout travaux influents.
Ces mesures pré-travaux servent de zéro à partir duquel on calculera les évolutions. Par exemple, relever les inclinomètres plusieurs fois pour vérifier qu’aucun déplacement n’est en cours (et ainsi détecter d’éventuels phénomènes préexistants, comme un glissement lent), ou mesurer la nappe sur une période représentative pour connaître son niveau naturel (et sa variabilité saisonnière).
Des lignes de base stables garantissent que toute variation ultérieure provient bien des travaux et non d’un bruit de fond initial non détecté. - Pendant les phases critiques du chantier : C’est évidemment durant les étapes les plus risquées qu’il faut intensifier la fréquence des mesures.
Le PCG doit prévoir d’augmenter la vigilance lors : de l’excavation d’un sous-sol (pics de déformation des soutènements), de la mise en charge d’un remblai ou d’une fondation (pics de tassement et de pression interstitielle), du rabattement de nappe, etc.
Par exemple, lors du creusement d’une tranchée soutenue par palplanches, on pourra passer d’un relevé inclinométrique hebdomadaire en phase de terrassement initial à un relevé quotidien lorsque la fouille atteint sa profondeur maximale. Si les instruments le permettent (capteurs automatisés), on peut configurer des acquisitions quasi en continu durant un coulage de béton critique ou un étape de butonnage, afin de ne rater aucun comportement anormal.
L’important est d’avoir une stratégie pré-planifiée mais adaptable : le plan d’auscultation doit indiquer la fréquence de base par phase, tout en stipulant que celle-ci pourra être revue à la hausse en cas d’événement imprévu ou de tendance inquiétante, conformément aux principes Eurocode (méthode observationnelle).
Par exemple, si un tassement commence à s’accélérer plus qu’anticipé, on pourra densifier les mesures (passer de hebdomadaire à journalier, voire installer un système automatique) pour suivre de près l’évolution. - Post-construction / période d’observation – Une fois l’ouvrage achevé ou la charge appliquée, il est recommandé de maintenir un suivi pendant un certain temps afin de vérifier la stabilisation.
Cette période d’observation post-travaux (quelques semaines, mois, voire années selon l’ouvrage et les risques résiduels) voit généralement une décroissance contrôlée des fréquences de mesure.
Par exemple, après la fin d’une excavation et le décoffrage d’une enceinte, on continuera les relevés inclinométriques et les nivellements quotidiennement pendant une semaine, puis si tout est calme on passera à hebdomadaire le mois suivant, puis mensuel, etc., jusqu’à retrouver une tendance de fond stable (plus de mouvement notable sur 2 ou 3 campagnes successives).
Cette démarche permet de lever le doute avant de démonter les instruments : on s’assure que l’ouvrage et le sol se comportent bien à long terme dans le régime prévu, sans dérive tardive.
En orchestrant ainsi la surveillance sur l’ensemble du cycle de vie du chantier (avant, pendant, après travaux), on se donne les meilleures chances de détecter les écarts significatifs et de réagir à temps.
La clé est d’anticiper les phases sensibles mais aussi de savoir prolonger la veille géotechnique si nécessaire, jusqu’à ce que la situation soit définitivement sous contrôle.
Fréquences de mesure : grilles indicatives (à adapter selon le risque)
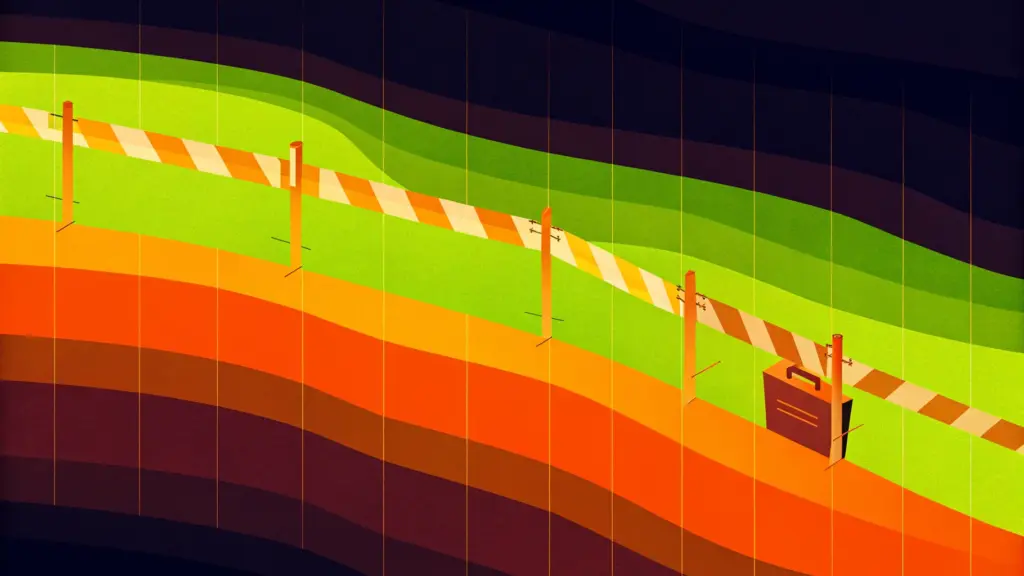
Le PCG doit fournir une grille de fréquences de mesure pour chaque instrument et chaque phase du chantier, en gardant à l’esprit qu’il s’agit d’indications à affiner selon les risques propres à l’ouvrage. Voici des ordres de grandeur usuels :
- Inclinomètres : en phase de calme (terrassement non engagé, ou pause de chantier), un relevé hebdomadaire peut suffire pour vérifier l’absence de mouvement.
En phase d’excavation active ou de soutènement sous charge, on passe en quotidien voire pluriquotidien. Par exemple, les guides USACE conseillent des lectures journalières ou plus fréquentes lors de remblais rapides, soutènements sollicités, etc.
Si des inclinomètres in-place automatiques sont installés (MEMS câblés), on peut programmer des acquisitions continues (toutes les heures par exemple) pour les ouvrages très sensibles (tunnels sous infrastructure, fouilles profondes en milieu urbain).
Dès que l’évolution mesurée se stabilise sur plusieurs jours, on peut espacer progressivement (tous les 2 jours, puis hebdo).
À noter : toujours regrouper les mesures au même horaire pour tous les instruments d’une même zone – idéalement simultanément – afin de mieux corréler les phénomènes (par exemple faire coïncider la lecture d’un inclinomètre et du piezomètre voisin pour lier pression interstitielle et déplacement). - Piézomètres : pour les tubes ouverts (standpipes), une mesure hebdomadaire peut suffire en régime normal, mais en phase transitoire (pompage, forte pluie, excavation sous nappe) on ira vers du quotidien ou biquotidien manuel.
Les piézomètres à corde vibrante connectés à un enregistreur permettent un suivi bien plus fréquent – typiquement une mesure toutes les 10 minutes ou toutes les heures – utile par exemple sur une digue ou un barrage où l’on craint une montée brusque de la pression interstitielle.
Dans un contexte urbain, on pourra loger un enregistreur automatique sur des piézomètres surveillant les effets d’une excavation pour avoir un historique en continu (pas de 15 min par ex.) tout en faisant des relevés manuels de vérification une fois par semaine.
Pour les ouvrages où la nappe est moins critique, on pourra réduire à mensuel une fois l’ouvrage stabilisé et si les variations sont faibles.
Comme toujours, la fréquence doit être revue en cas d’anomalie : une remontée imprévue de nappe impose d’accélérer le rythme des mesures pour suivre l’évolution de près. - Tassements (nivellements) : lors des phases de terrassement/remblaiement actives, on effectuera un nivellement très fréquent des points de contrôle – souvent quotidien sur ouvrage sensible.
Par exemple, pour un remblai sur sol compressible, un relevé quotidien des plaques de tassement permet de suivre la courbe de consolidation et d’atteindre les objectifs de tassement préchargement.
Sur un bâtiment avoisinant une excavation, un nivellement de précision des repères peut être fait chaque matin pour vérifier l’absence de mouvement nocturne. Ensuite, hors phase active, on espace à hebdomadaire, puis mensuel, etc., comme indiqué précédemment.
L’apport des systèmes automatisés est précieux ici : une station totale robotisée (AMTS) peut viser des prismes sur les structures en continu, par exemple une mesure toutes les 20 minutes sur un immeuble mitoyen en cours de sous-œuvre . Cela crée de la redondance et permet de filtrer les données brutes par moyennes glissantes, améliorant la fiabilité des tendances.
Pour un suivi de longue durée (après chantier, phase de service initiale), on pourra réduire à mensuel ou trimestriel si les données se sont stabilisées.
Nota Bene : L’Eurocode 7 (EN 1997-1) rappelle que la fréquence des observations doit être réévaluée en cas d’événements inattendus ou de comportements imprévus . Autrement dit, nos grilles de fréquence ne sont pas figées : si un instrument détecte une dérive anormale (par exemple tassement dépassant la prévision), on augmente sans attendre la fréquence de mesure et on élargit éventuellement le périmètre de surveillance (installation de capteurs supplémentaires) pour sécuriser le chantier. Mieux vaut trop de mesures que pas assez lorsque le doute s’installe – on pourra toujours redescendre en fréquence une fois l’évolution comprise et maîtrisée.
Seuils d’alerte & actions du Statut RAG (Green/Amber/Red)

Définir des seuils d’alerte clairs est au cœur de l’approche observationnelle.
Ces seuils transforment les données brutes en décision : faut-il agir, et comment ?
La méthode consiste à établir, pour chaque instrument ou indicateur suivi, des valeurs repères correspondant aux niveaux de vigilance Vert, Orange et Rouge – par analogie au feu tricolore :
- Green (Vert) : comportement normal, conforme aux prévisions. Les mesures restent en dessous d’un premier seuil d’alerte dit limite de service. Tout est « vert », on poursuit le chantier normalement. Par exemple, un inclinometre montrant un déplacement de 5 mm là où 15 mm étaient attendus en fin de fouille restera en vert.
- Amber (Orange) : atteint lorsque l’on sort du comportement attendu sans être dangereux pour autant. C’est un seuil d’avertissement qui déclenche des mesures de précaution. Typiquement, on constate une dérive notable : il faut alors intensifier la surveillance (passer de hebdomadaire à journalier, installer des points supplémetaires) et enquêter sur la cause. On prévient toutes les parties prenantes qu’une dérive est en cours, et on se tient prêt à intervenir si besoin . Par exemple, si un tassement atteint 80% de la valeur admissible calculée, on passe en surveillance renforcée et on étudie des solutions de mitigation.
- Red (Rouge) : seuil critique au-delà duquel la sécurité ou la stabilité peuvent être compromises. Il exige des actions correctives immédiates et potentiellement l’arrêt des travaux en cours . Par exemple, un tirant qui dépasse sa charge maximale admissible, ou un piezomètre qui enregistre une pression excédant la résistance du sol, déclenchera le plan d’action d’urgence (soulager la structure, évacuer la zone, etc.). En pratique, le seuil rouge est souvent fixé proche de la valeur ultime tolérée (ou d’un facteur de sécurité minimal).
Cette hiérarchie Vert/Orange/Rouge doit être définie à l’avance dans le PCG, en se basant sur les notes de calcul de conception (G2/G3).
On dérive les seuils vert et rouge à partir des valeurs prévues : par exemple, si le calcul de butonnage anticipe 20 mm de déplacement max, on pourrait mettre le seuil orange à ~15 mm et le rouge à ~25 mm (soit légèrement au-dessus du calculé, en restant dans la marge de sécurité de l’ouvrage).
De même pour la nappe : on peut fixer un seuil orange si la baisse de nappe dépasse ce qui était modélisé, et un seuil rouge si la nappe descend à un niveau risquant d’affecter des fondations voisines.
Il est important de documenter comment chaque seuil a été choisi (référence au calcul, à l’expérience sur des cas similaires, ou à des critères normatifs).
En complément, le PCG doit prévoir pour chaque seuil franchi la réponse appropriée (qui fait quoi). Ceci constitue le plan d’actions face aux déclencheurs. Par exemple :
- Alerte Orange – Action : informer immédiatement l’ingénieur géotechnicien et la MOE, augmenter la fréquence des mesures (ex. passer de hebdo à quotidien) , inspecter visuellement la zone si possible, vérifier les autres instruments pour chercher des corrélations (par ex. hausse de pression d’eau en même temps qu’un déplacement), préparer un plan de mesure additionnel (forages, etc.), et étudier des mesures de renforcement temporaires (étaiements supplémentaires, diminution du rythme de terrassement).
- Alerte Rouge – Action : arrêt immédiat des travaux en cours dans la zone concernée, mise en sécurité du chantier (évacuation du personnel à proximité si danger, sécurisation des accès), mobilisation de la cellule de crise géotechnique. On déclenche alors les plans de contingence définis dès le départ : par exemple injecter en urgence pour stabiliser un terrain, relâcher un tirant sur-solicité, pomper l’eau si la nappe monte trop, etc. L’important est que ces actions aient été anticipées et planifiées autant que possible, afin de pouvoir les mettre en œuvre sans délai. Eurocode 7 insiste pour que les plans de contingence soient prêts avant même de commencer les travaux . Une communication immédiate à tous les acteurs (MOA, autorités éventuellement) est faite.
Chaque événement d’alerte (orange ou rouge) doit faire l’objet d’une traçabilité rigoureuse : fiche d’événement relatant date/heure, instrument concerné, valeur mesurée, seuil dépassé, conditions environnementales, etc. Ensuite, une revue de risque est tenue (souvent en cellule de crise géotechnique) pour analyser la cause de la dérive. Sur cette base, on pourra être amené à recalculer certaines justifications d’ouvrage en incluant les nouvelles données mesurées, afin de vérifier la tenue de l’ouvrage dans sa configuration actuelle ou modifiée.
C’est là tout l’esprit de l’approche observationnelle : le projet évolue en fonction du comportement réel observé. Tant que les seuils verts dominent, on continue selon le plan initial ; si l’orange survient, on ajuste le plan ; si le rouge survient, on applique les mesures d’urgence puis on revoit éventuellement la conception (par exemple augmenter le nombre de tirants, changer la méthode d’excavation, etc.).
Enfin, une fois l’alerte résolue, un retour d’expérience doit être documenté pour enrichir la connaissance du projet (et des projets futurs).
Assurance qualité des mesures
Une instrumentation n’a de valeur que si ses données sont fiables et correctement interprétées. Le PCG doit intégrer un plan d’Assurance Qualité (QA/QC) des mesures, couvrant notamment :
- Tests et calibrations initiales : Avant et pendant l’installation, chaque instrument doit être vérifié.
Par exemple, un inclinomètre manuel sera contrôlé en le tournant à 180° dans le tube pour s’assurer que la courbe de zéro est cohérente (compensation des erreurs de sonde) – on appelle ça un test de répétabilité.
Un piézomètre sera testé en le pressurisant à une valeur connue (ou en comparant son niveau d’eau à un puits voisin) pour vérifier qu’il indique correctement la pression.
Les manuels fournisseurs fournissent généralement les courbes d’étalonnage en laboratoire ; sur le terrain, on doit réaliser une calibration de terrain si possible (par exemple relever la température et la pression atmosphérique pour compenser leurs effets sur les capteurs vibrants).
Dunnicliff recommandait une inspection qualité de chaque instrument avant expédition sur site, suivant une checklist précise (conformité au cahier des charges, certificats d’étalonnage, test de bon fonctionnement) – un gage de fiabilité dès le départ. - Suivi des dérives et maintenance : Une fois en place, un capteur peut dériver (usure, encrassement) ou même se briser (forage qui s’effondre sur un tube d’inclinomètre, câble arraché par inadvertance, etc.). Le plan doit prévoir des points de contrôle périodiques pour s’en apercevoir.
Par exemple, si deux inclinomètres sont voisins et que l’un indique subitement un déplacement très différent de l’autre, c’est un signal soit d’une localisation de mouvement très limitée… soit d’un problème sur l’appareil. De même, une jauge de piezomètre stable alors qu’il a plu énormément est suspecte (bouchon dans le tube ? capteur saturé ?).
En pratique, l’ingénieur G3 doit analyser les données au fur et à mesure pour détecter toute incohérence. Il est conseillé de comparer les mesures d’un instrument non seulement à ses propres historiques, mais aussi aux autres capteurs environnants (ex : comparer tassements et inclinaisons, ou pressions eau et déplacement) pour voir si ça « fait sens ».
Si une mesure paraît aberrante, on effectue un relevé de contrôle immédiatement : par exemple remesurer l’inclinomètre le lendemain pour confirmer s’il y a vraiment eu mouvement ou si c’était une erreur de lecture.
Ce processus de vérification continue est crucial : un célèbre retour d’expérience montre qu’un suivi d’inclinomètres sur deux ans n’avait jamais été exploité, et lorsque le besoin est venu, on a découvert des erreurs évidentes de mesure et de calibration rendant les données inexploitables.
La solution est de vérifier en continu : comparer chaque nouvelle mesure à la précédente, refaire la mesure en cas de doute, et valider que les évolutions observées sont plausibles (corrélées à une étape de chantier ou un événement). - Redondance et plan B : Une bonne pratique de QA est de ne pas dépendre d’un seul type de mesure pour un aspect critique.
Par exemple, pour suivre un tassement important, on peut avoir à la fois une plaque topographique et un extensomètre profond ; si les deux divergent fortement, on investiguera, mais si l’un lâche, l’autre prend le relais.
De même, coupler un suivi géodésique en surface avec des inclinomètres profonds permet de recouper les informations sur un mouvement de sol. En cas de bris d’un capteur, le PCG doit prévoir soit un remplacement (si possible) soit l’utilisation d’une méthode alternative.
Un autre exemple, si un tube inclinométrique est écrasé et inutilisable, on pourra mettre en place un prisme optique sur la paroi correspondante pour continuer à suivre le déplacement.
L’objectif est qu’aucun phénomène critique ne soit suivi par un unique capteur sans solution de secours. - Procédures d’acquisition et traitement des données : Il est important de formaliser comment les données sont collectées, transmises, stockées et exploitées, afin d’éviter les erreurs humaines.
Cela passe par des protocoles écrits : mode opératoire de relevé manuel (ex : toujours effectuer 3 lectures consécutives d’un niveau d’eau pour fiabiliser), procédure de saisie et réduction des données (logiciel utilisé, unité, corrections appliquées…), gestion des unités et des références (ex : préciser que les tassements sont en mm par rapport au relevé initial du 01/10/2025).
Les normes ISO 18674 sur le monitoring insistent sur la traçabilité et l’évaluation des incertitudes : chaque mesure doit être rattachée à son contexte (date, heure, conditions, opérateur) et comporter une estimation de sa précision.
Ainsi, on documentera par exemple qu’un nivellement manuel a une incertitude ±2 mm, alors qu’une mesure automatique laser pourrait être ±5 mm, ce qui compte dans l’interprétation. En termes de QA, on aura des formulaires ou base de données garantissant que rien n’est perdu ni altéré.
En appliquant un tel plan d’assurance qualité, on s’assure que les données d’auscultation géotechnique sont fiables, cohérentes et exploitables. C’est indispensable pour pouvoir prendre des décisions de chantier en toute confiance.
Rappelez-vous : « garbage in, garbage out » – des décisions basées sur des données erronées peuvent être pires que pas de données du tout. Donc mieux vaut passer du temps à fiabiliser la mesure plutôt que de courir à l’aveuglette.
Gestion des données, tableaux de bord & reporting
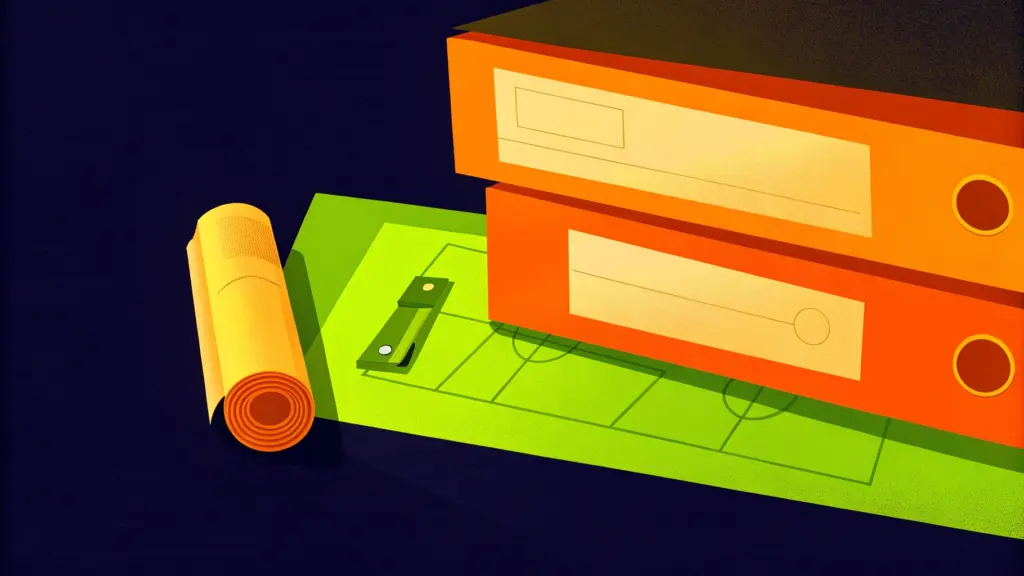
La surveillance géotechnique génère rapidement une grande quantité de données qu’il faut gérer efficacement. Deux approches existent souvent en parallèle : l’acquisition manuelle traditionnelle et le suivi automatisé.
Acquisition manuelle vs automatique : En G3, on combine souvent des relevés manuels (par exemple un géomètre qui fait un nivellement chaque matin) et des systèmes automatiques (un enregistreur connecté à des capteurs, envoyant les données en continu). L’acquisition manuelle a l’avantage de la simplicité et du regard humain (l’opérateur sur le terrain peut noter des observations qualitatives), mais elle présente un délai et une fréquence limitée.
L’acquisition automatique, elle, permet du quasi temps réel : les capteurs sont reliés à des data loggers qui enregistrent et transmettent en continu vers un système central. Un système d’acquisition automatique centralisé – parfois appelé ADAS pour Automatic Data Acquisition System – collecte les données de multiples capteurs, les stocke dans une base de données et peut même gérer des alarmes en temps réel sur dépassement de seuil préétabli.
Par exemple, un enregistreur de piezomètres vibrants enverra une alerte SMS/email au géotechnicien si la pression dépasse le seuil orange.
Ce genre de télésurveillance présente un énorme avantage : réactivité immédiate en cas de problème, sans attendre le passage d’un opérateur.
En pratique, on utilise souvent un mix : des lectures manuelles régulières pour confirmer et compléter (surtout sur des points où on n’a pas d’automate), et des capteurs critiques en continu pour la vigilance 24h/24.
Contrôle quotidien des données : Qu’elles soient manuelles ou automatiques, les données d’auscultation doivent être surveillées quotidiennement par l’ingénieur chargé du suivi.
Pour les systèmes automatiques, cela signifie vérifier chaque jour (ou en continu) le tableau de bord des mesures, s’assurer que les transmissions fonctionnent, qu’aucune dérive suspecte n’apparaît ou qu’aucune alarme n’est survenue pendant la nuit. En cas d’alarme, une procédure d’escalade immédiate doit être en place (par ex. l’automate envoie un SMS au géotechnicien de permanence).
Pour les relevés manuels, le géotechnicien les consigne dans la base de données le jour même et les compare aux valeurs précédentes. Aucun délai ne doit exister : plus on attend pour analyser, plus on risque de laisser passer un signal précurseur important. On pourra programmer des rapports automatiques quotidiens si le volume le justifie, ou au moins un check-in chaque matin. Les systèmes modernes (logiciels spécialisés) permettent de mettre des flags sur des mesures hors tolérance pour attirer l’attention de l’ingénieur dès l’import des données.
Tableaux de bord visuels : Pour exploiter efficacement les données brutes, rien ne vaut des visualisations graphiques.
Quelques exemples de dashboard géotechnique à mettre en place :
- Profil cumulatif d’inclinaison : un graphique montrant la forme de la courbe de déplacement horizontal cumulé d’un inclinometre, à différentes dates superposées. Cela permet de voir où se localise la déformation maximale et comment elle évolue dans le temps.
- Hydrogramme piézométrique : un graphique montrant le niveau d’eau ou la pression en fonction du temps, souvent comparé aux précipitations ou au planning de pompage. On y voit les réponses du piezomètre aux événements (pluie, pompage, etc.) et le retour au régime naturel.
- Courbe tassement-temps : pour chaque point de tassement, un graphique temps vs tassement cumulé, idéalement avec une autre courbe représentant la vitesse de tassement (mm/jour) en fonction du temps. La diminution de la vitesse indique la stabilisation.
- Cartographie : une vue en plan du chantier avec des flèches de déplacement ou des bulles de tassement de taille proportionnelle aux valeurs mesurées, mise à jour au fur et à mesure, peut aider en réunion de chantier à localiser les zones qui bougent.
Les données automatiques facilitent ces visualisations en temps réel.
On peut également calculer des indicateurs dérivés : par exemple, extraire la tendance ou la moyenne mobile d’une série pour lisser les variations jour/nuit, ou cumuler les déplacements d’un point de mesure pour avoir la valeur absolue (certains logiciels le font automatiquement pour les inclinomètres en additionnant les delta entre chaque relevé).
Dans le même esprit, un ADAS avancé peut convertir des données brutes en grandeurs ingénieur : par ex., convertir la déformation unitaire mesurée sur une jauge de strain en contrainte ou en charge appliquée, si on a défini les paramètres (module de Young, section) .
Reporting et livrables périodiques : Le PCG doit lister les rapports à fournir.
En général, on distingue :
- Un rapport de chantier hebdomadaire (ou bimensuel) de suivi géotechnique, produit par l’ingénieur G3 à destination du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. Il contient un résumé des faits marquants de la semaine, les tendances observées, des graphiques actualisés, et une conclusion du géotechnicien sur la stabilité (par ex. «
Tout évolue dans le vert, RAS, on poursuit le terrassement comme prévu » ou au contraire « L’inclinaison du voile atteint le seuil orange, on recommande de ralentir l’excavation »). Ce rapport hebdo inclut généralement en annexe l’ensemble des relevés bruts de la période pour archivage. - Des bulletins d’alerte immédiats en cas de dépassement de seuil : ce sont des notes succinctes émises ad hoc dès qu’un seuil orange ou rouge est franchi, pour informer toutes les parties (maître d’ouvrage, CSPS si pertinent, etc.) de la situation et des mesures engagées.
Le bulletin d’alerte rappelle le contexte (quel instrument, quelle valeur, seuil dépassé), décrit les actions immédiates menées et indique les décisions quant à la poursuite des travaux. C’est un document formel qui peut être très court (une page) mais qui trace l’événement. Il peut déclencher une réunion de crise si nécessaire. - En fin de mission, un rapport de fin de suivi / rapport de mesure final est produit, souvent intégré au Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).
Celui-ci récapitule toute l’instrumentation mise en place (avec plans de repérage as-built des capteurs installés), fournit toutes les séries de mesures brutes et traitées, et présente une analyse finale montrant que l’ouvrage est stable et conforme aux attentes ou explicite les écarts résiduels.
Le fascicule 70 du CCTG (Gestion des risques géotechniques) recommande d’ailleurs de fournir en fin de chantier les enregistrements et résultats de surveillance obtenus pendant les travaux, pour archivage sur la durée de vie de l’ouvrage .
Pour gérer tout ceci, des outils informatiques dédiés sont souvent utilisés (bases de données de monitoring, plateforme web de suivi accessible au client, etc.).
L’important est que le bon message parvienne aux bonnes personnes au bon moment : un tableau de bord en ligne ne dispense pas de rédiger des notes de synthèse interprétatives, et inversement un rapport PDF ne remplace pas l’utilité d’une alarme instantanée.
Le PCG doit donc articuler clairement comment les données deviennent de l’information, puis de la décision.
Livrables attendus (trames prêtes à l’emploi)
La mission G3, via le PCG, doit fournir un certain nombre de livrables documentaires. Voici ceux qu’il convient généralement de préparer (le blog Geo2mo pourra vous fournir des trames sur demande) :
- Plan de Contrôle Géotechnique G3 – C’est le document central qui peut figurer en annexe du Plan Qualité chantier. Il décrit : les objectifs du suivi, le périmètre (ouvrages, zones, phases couverts), le tableau RACI des intervenants, la liste détaillée des capteurs installés (type, nombre, précision), leurs implantations (avec plans et coordonnées), la méthodologie de mesure (fréquences prévues, mode de collecte), les seuils d’alerte Green/Amber/Red retenus avec leur justification, et les actions correspondantes. Il peut inclure aussi des check-lists de mise en œuvre, et il fait le lien avec le PAQ.
Ce document doit être validé par les parties prenantes (MOE, G4 le cas échéant) avant le début des travaux et diffusé à tous ceux qui ont un rôle dans la surveillance.
Il répond en partie aux exigences de la norme NF P 94-500 pour la mission G4, qui demande la définition d’un programme d’auscultation et de valeurs seuils de surveillance dès la supervision de l’étude d’exécution . - Fiches techniques des capteurs – Pour chaque instrument installé, il est judicieux de préparer une fiche récapitulative. Par exemple une fiche inclinomètre mentionnera : l’identifiant du forage et son emplacement (repère de plan, coordonnées), la profondeur totale forée, le type de tube (PVC Ø70 mm rainuré), la date d’installation, la profondeur de scellement en pied (et nature du terrain en pied), le nom de l’installateur, les tests effectués (contrôle verticalité, essai de sonde initial), la fréquence de mesure prévue, les seuils spécifiques (par ex. 3 mm vert, 6 mm orange, 10 mm rouge cumulés sur 5 m). Idem pour une fiche piézomètre : type (Casagrande ou VW), cote du filtre, niveau d’eau initial, etc.
Ces fiches servent de référence rapide en cours de chantier (pour savoir, par exemple, à quelle profondeur est le filtre d’un piezo quand on voit la nappe bouger). Elles peuvent être annexées au PCG ou au dossier de fin. - Procédures d’exécution et de contrôle qualité – Souvent intégrées au Plan Qualité, ces procédures décrivent comment les instruments doivent être installés et contrôlés. Par exemple, une procédure d’installation de piezomètre indiquera étape par étape la réalisation du forage, la mise en place du tube et du filtre, l’injection du scellement, le test de purge, etc., avec les critères d’acceptation (si le niveau d’eau ne se stabilise pas après 1 h, ne pas valider l’installation…).
De même, une procédure de mesure inclinometrique pourra préciser la technique de double lecture (0°/180°) et l’exploitation logicielle.
Ces procédures garantissent que l’auscultation est réalisée dans les règles de l’art de manière homogène, même si plusieurs opérateurs se succèdent. Elles s’appuient sur les référentiels normatifs ISO 18674 et les recommandations reconnues (CETU, CFMS…).
Intégrer ces documents au PAQ de l’entreprise est une bonne pratique (le guide CETU Fascicule 69 encourage à inclure les dispositifs d’auscultation dans le cadre contractuel qualité du chantier ). - Rapports de mesures – En plus du plan initial, le géotechnicien produira les rapports en cours de chantier : le rapport initial de référence (synthèse de toutes les mesures de pré-travaux, servant de base officielle), les rapports périodiques (hebdomadaires, mensuels selon contrat), et en fin de projet un rapport final (DOE instrumentation).
Ce dernier comportera généralement : un descriptif final as-built des instruments (avec plans mis à jour si certains capteurs ont été déplacés/supprimés en cours de route), l’historique complet des mesures (souvent en annexe ou fichier Excel), et une interprétation finale démontrant la stabilité ou expliquant les écarts. Il fait partie intégrante du DOE du marché travaux et peut servir de base au suivi en phase d’exploitation (mission G5 si elle a lieu). - Matrice de suivi “Green/Amber/Red” – Utile en annexe du PCG, ce tableau récapitule pour chaque instrument/paramètre les seuils chiffrés et les actions correspondantes.
Par exemple : Inclinomètre I5 – Seuil Vert : déplacement < 5 mm (conforme) ; Seuil Orange : ≥ 5 mm et < 8 mm (alerte, augmenter surveillance, vérifier calcul) ; Seuil Rouge : ≥ 8 mm (stopper travaux, contreventement supplémentaire…). Ce format de matrice feu tricolore est très parlant pour l’équipe de chantier, et largement utilisé dans les projets d’infrastructure majeurs. - Check-lists et formulaires – En annexe, on peut joindre les modèles de fiche de mesure vierge (formulaire de relevé manuel à remplir, par ex. pour relever un piézomètre on note date/heure, niveau mesuré, température), ou des check-lists de réception d’instrument (ex : checklist de contrôle d’un inclinomètre après installation, incluant vérification de verticalité, nettoyage, premier profil cohérent, etc.).
Ces documents pratiques, inspirés par des synthèses comme le NCHRP 89 de la TRB (Dunnicliff), aident à ne pas oublier d’étapes dans le feu de l’action.
L’élaboration de ces livrables peut sembler fastidieuse, mais c’est un investissement qui professionnalise le suivi géotechnique. Un PCG bien documenté et complet met en confiance le maître d’ouvrage, rassure le maître d’œuvre, et fournit à l’entreprise un mode d’emploi clair pour l’auscultation.
De plus, en cas de litige ou d’expertise, ces documents feront foi de la bonne gestion du risque géotechnique pendant le chantier.
Check-lists & modèles en annexe
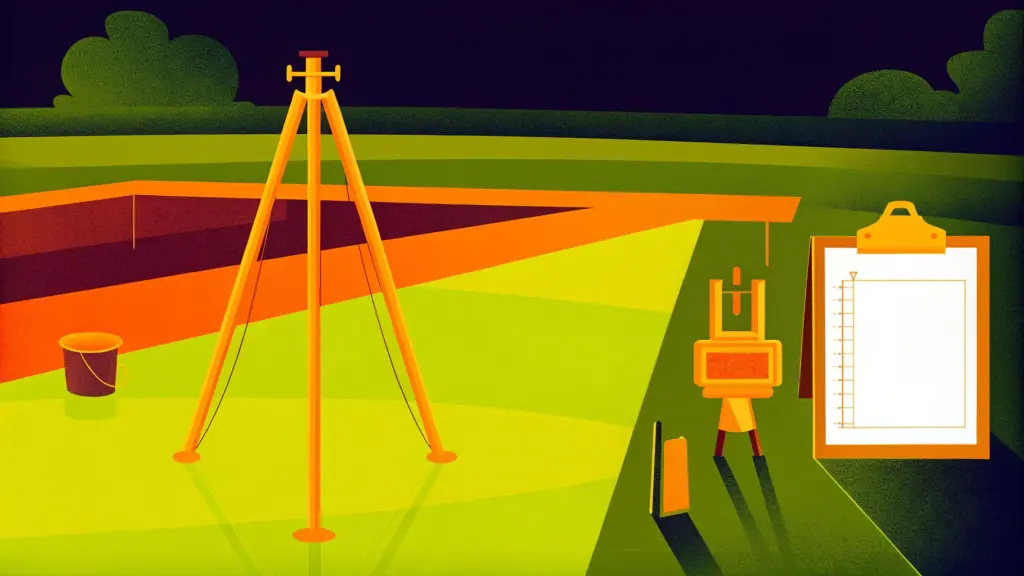
Pour aider à la mise en œuvre, un PCG G3 peut s’accompagner de documents types et listes de contrôle, par exemple :
- Grille de fréquences recommandées – Tableau récapitulant, par type d’ouvrage et de capteur, les fréquences de mesure minimales.
Par ex. : Fouille soutenue en milieu urbain – inclinomètres quotidiens en phase excavation, puis hebdo en maintien ; piezomètres horaire automatique ; nivellement quotidien sur avoisinants. Ou Remblai sur sol compressible – plaques de tassement quotidiennes en phase construction, hebdo en consolidation, etc. Cette grille sert de point de départ et est adaptée au cas par cas dans le PCG. - Matrice Green/Amber/Red – Comme évoqué plus haut, une matrice listant les seuils et actions associées. Ce document synthétique (souvent une simple page) est très utile en réunion de chantier pour rappeler à tous les niveaux d’alerte. On y inclut aussi les contacts à prévenir en cas d’alerte (ex. alerte rouge : Appeler immédiatement M. X (ingénieur géotechnicien), Tel…).
- Fiche de recette capteur – Liste de contrôle utilisée lors de l’installation d’un instrument, pour valider que tout est conforme. Par ex., pour un inclinomètre : Forage nettoyé, profondeur atteinte, tube assemblé correctement (joints OK), verticalité mesurée < 1%o, tube coiffé et verrouillé, coulis injecté du bas vers le haut, bouchon de tête posé, première lecture effectuée et profil cohérent. L’installateur et le géotechnicien signent cette fiche, qui garantit la qualité initiale de la mise en place. Des modèles existent dans la littérature (Dunnicliff en propose dans son ouvrage).
- Modèle de Plan de Contrôle Géotechnique – Une trame de document indiquant tous les chapitres à couvrir (contexte du projet, responsabilités, instrumentation, seuils, etc.), pouvant être reprise d’un projet à l’autre en l’adaptant.
De même, un modèle de rapport hebdomadaire peut être fourni, avec sections prédéfinies (Résumé, Observations de la semaine, Alertes et actions, Données brutes en annexe).
Cela fait gagner du temps et assure une cohérence de présentation.
Ces outils pratiques ne figurent pas toujours dans les documents contractuels, mais ils font souvent la différence entre un suivi approximatif et un suivi professionnel.
N’hésitez pas à standardiser et réutiliser ces check-lists d’un projet à l’autre – la géotechnique observationnelle est un domaine où l’expérience compte énormément, et chaque projet instrumenté enrichit le savoir-faire pour le suivant.
Faire appel à Geo2mo pour votre mission G3
Vous avez besoin d’un Plan de Contrôle Géotechnique G3 prêt à l’emploi pour votre chantier (par exemple en Occitanie) ?
Geo2mo est là pour vous accompagner.
Nos ingénieurs conçoivent des plans d’instrumentation sur mesure, définissent avec vous les seuils d’alerte et les actions, et fournissent toutes les trames de rapports et fiches de suivi dont vous avez besoin.
Ne laissez pas l’incertitude géotechnique mettre en péril votre projet – adoptez l’approche observationnelle en toute confiance.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour un devis sous 48h et sécurisez vos travaux grâce à un suivi géotechnique professionnel et réactif.
Votre chantier mérite la tranquillité d’esprit : avec Geo2mo, maîtrisez le terrain avant qu’il ne vous maîtrise !


