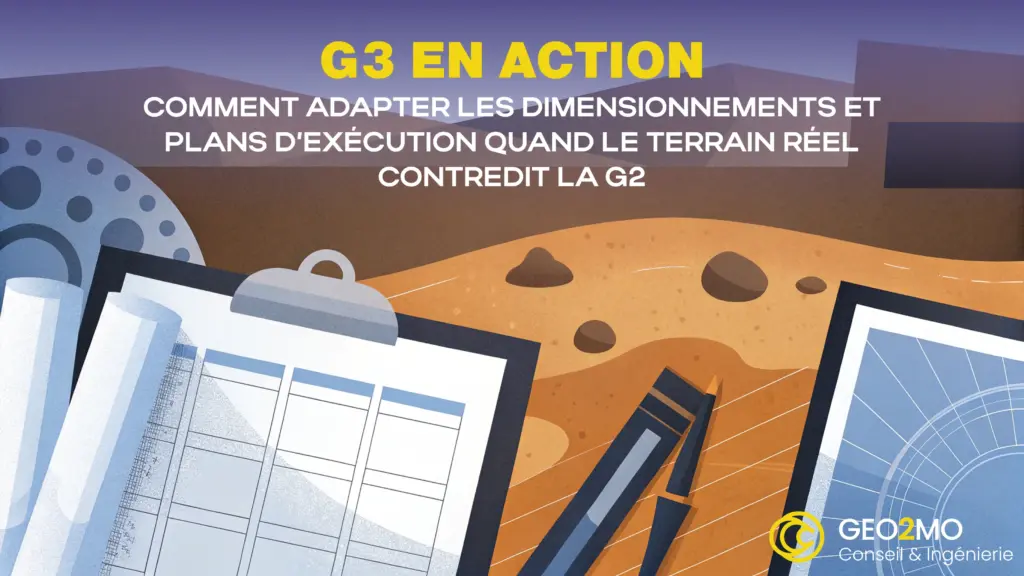En phase G3, le chantier peut révéler une portance plus faible que prévue, une nappe phréatique plus haute ou des hétérogénéités non anticipées.
L’enjeu est de recalculer rapidement et précisément les fondations et de mettre à jour les plans d’exécution (phases, méthodes, renforcement, etc.) pour sécuriser le phasage et maîtriser les coûts.
Cette mission G3 vise à réduire les risques géotechniques résiduels en mettant en œuvre à temps les mesures correctives nécessaires, conformément à la norme NF P 94-500 et à l’Eurocode 7 (méthode observationnelle).
Le rôle de la G3
La mission G3 (« étude et suivi géotechnique d’exécution ») intervient une fois les travaux préparatoires engagés.
Son objet est de confirmer/ajuster le modèle géotechnique établi en G2 et d’élaborer ou mettre à jour le dossier d’exécution des ouvrages (notes de calcul, plans de phasage et d’auscultation, méthodes constructives, etc.), puis de suivre les travaux et d’appliquer des actions correctives si nécessaire (méthode observationnelle).
- Objet : confirmer ou réajuster le modèle géotechnique sur la base des relevés et essais G3 et de l’évolution du chantier, mettre à jour les notes de calcul et plans d’exécution (fondations, soutènements, terrassements, etc.), et déclencher des mesures correctives si un dépassement de seuil est constaté (suivi par instrumentation).
- Livrables clés : plans EXE révisés (implantation, armatures, phasage, méthodes d’exécution), notes de calcul G3 détaillées, fiches « points d’arrêt » ou critères de reprise, Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et Dossier d’Interventions Ultérieures (DIUO).
- Base normative : la NF P 94-500 définit l’enchaînement des missions G1→G2→G3/G4 et leurs contenus respectifs, et l’Eurocode 7 autorise explicitement la méthode observationnelle pour gérer l’incertitude en phase d’exécution (coefficients partiels révisables, seuils de contrôle, boucles mesure-réaction).
Pour en savoir plus sur la mission G3 et son cadre réglementaire, voir la page Mission G3 (pilier du sujet) et la différence G3 vs G4 pour le contrôle et la supervision.
Quand et pourquoi adapter ? Les signaux d’alerte G3
En G3, on doit rester vigilant à tout écart avec les hypothèses G2. Les signaux d’alerte majeurs comprennent notamment :
- Portance inférieure aux prévisions : par exemple des essais de pénétration statique (CPT), dilatométriques (DMT/PMT) ou des essais de plaque qui révèlent une capacité portante réduite. Cela peut compromettre les états-limites ultimes et de service (stabilité, tassements).
- Nappe phréatique plus haute / venues d’eau : apparition imprévue d’une nappe ou d’exutoires d’eau entraîne des surpressions interstitielles, qui affectent la stabilité provisoire des fouilles et des talus et accroissent les tassements de sol.
- Terrain plus compressible ou stratigraphie différente : découverte de couches plus molles ou plus épaisses que prévu conduit à réviser les valeurs caractéristiques (φ, c, module E) du modèle géotechnique.
- Déformations mesurées supérieures aux seuils : si les relevés d’instruments (inclinomètres, piézomètres, jauges) dépassent les valeurs seuils définies en G2, cela déclenche une démarche corrective selon la méthode observationnelle EC7 (boucles mesure-réaction, plan d’actions).
En cas de constat de l’un de ces écarts, il faut déclencher sans délai le recalcul et la mise à jour du modèle géotechnique et des plans d’exécution.
Démarche de recalcul G3
Le recalcul G3 suit une démarche itérative qui doit être tracée et documentée. Les étapes opérationnelles sont :
- Constat & collecte de données : relever précisément l’écart avec le modèle G2 (résultats d’essais G3, mesures instrumentales, observations de terrain), et archiver les données (rapports, photogrammétrie, journaux de chantier).
- Recalage des paramètres : ajuster les paramètres géotechniques caractéristiques (sollicitations, cohésion, φ, E, etc.) et les coefficients partiels de sécurité selon l’Eurocode 7, puis mettre à jour le modèle numérique (sous-terrain 2D/3D, diagrammes de poussée de terre).
- Nouvelles notes de calcul G3 : rédiger des notes justificatives spécifiques (portance recalculée des fondations, stabilité des soutènements provisoires/définitifs, tassements ré-estimés, frottement négatif, effet de groupe, etc.).
- Plans EXE révisés : réactualiser tous les documents d’exécution (armatures, longueurs de pieux/barrettes, phasage de chantier, méthodes de réalisation et de reprise en sous-œuvre) en fonction des solutions retenues.
- Plan d’actions observationnelles : définir ou actualiser les seuils critiques, planifier le programme de monitoring (inclinomètres, extensiomètres, piézomètres, nivellements…) et les actions contingentes graduées en cas de dépassement (ex. augmentation de soutènement, épaisseurs d’injection complémentaires, renforcement de sol).
- Traçabilité & communication : numérotage des versions de notes et plans, diffusion organisée (MOE, entreprise, MOA) avec validation des modifications (tableau RACI projet). Le journal de bord du chantier et le DOE doivent être enrichis des écarts et mesures prises.
Cette boucle note de calcul/plan d’exécution/instrumentation est au cœur de la mission G3 (voir aussi les boucles mesure-réaction).
Chaque évolution doit être formalisée dans un rapport G3 avec hypothèses révisables.
Cas concrets & solutions-types (fondations)
Sur le terrain, un manque de portance ou une capacité portante moindre que prévu en G2 impose d’adapter le système de fondations pour garantir la stabilité et le service.
Il s’agit de choisir des variantes adaptées (bases élargies, solutions semi-profondes ou améliorations de sol) et de les recalculer.
Ces choix doivent intégrer les méthodes françaises (EC7 et NF P 94-261/-262) et bénéficier d’outils numériques spécialisés comme FOxta v4 (Terrasol) pour simuler portance, tassements et interactions sol-ouvrage.
4.1 Portance moindre que prévu (semelles / radiers)
- Solutions possibles : élargissement des semelles ou du radiers, passage à des fondations semi-profondes (pieux ou puits massifs), recours aux micropieux, inclusion de pieux rigides ou géosynthétiques, ou amélioration locale du sol (compactage dynamique, injections chimiques).
- Outils de recalcul : la suite FOxta v4 intègre des modules dédiés (FONDSUP, FONDPROF, TASPLAQ, TASSIELDO, etc.) pour dimensionner semelles, radiers et pieux selon l’EC7. Elle permet d’estimer le portance ultimes, les tassements et les effets de groupe. On exploite les lois de sol calibrées sur site (essais PMT, CPT, laboratoires) pour réévaluer les efforts admissibles et les déplacements.
(voir aussi le guide Micropieux vs fondations classiques pour comparer ce type de variantes)
4.2 Fondations profondes (pieux / barrettes)
- Réajustements : on peut modifier la profondeur et le diamètre des pieux ou barrettes pour atteindre des niveaux porteurs plus solides, ou redistribuer les charges en augmentant leur nombre. Il faut également vérifier l’éventuel frottement négatif (pieux dans un sol compressible) et l’interaction de groupe.
- Normes et outils : le dimensionnement suit l’Eurocode 7 (annexe nationale NF P 94-262 pour les fondations profondes) et le guide CEREMA « Fondations profondes ». Par exemple, on consulte la méthode du t-z ou Q-c pour recalculer la capacité des pieux en fonction des essais PMT/CPT. (Cf. page Dimensionnement de fondations profondes pour détails pratiques.)
4.3 Améliorations de sol & inclusions rigides (ASIRI)
- Solutions : matelas de transfert (semelle rigide sur couche compressible), géosynthétiques de renforcement, dispositifs d’inclusions rigides (pieux inclus dans le radier), ou injections de coulis au droit des semelles.
- Réglages : on calcule l’efficience via les modules ASIRI/ASIRI+ (méthode française pour l’optimisation des inclusions rigides) et on dimensionne la disposition (espacement, longueurs de pieux, géotextiles). Les effets sur tassements et charges transmises au sol sont réévalués en conséquence.
Ces variantes (puits, micropieux, inclusions, etc.) sont choisies selon l’ampleur du déficit de portance et le rapport coût/risque (cf. page sur Micropieux vs fondations classiques pour un comparatif).
Ouvrages spéciaux : soutènements & parois
Les études G3 concernent aussi les soutènements provisoires ou définitifs. Par exemple :
- Parois moulées / palplanches / berlinoises : si les poussées réelles dépassent les prévisions, il faut recalculer les efforts sur les parois et redimensionner tirants, butons ou ancrages. Le phasage (technique de creusement par élévation de tassement) et le niveau de la nappe en cours de travaux sont réévalués.
- Outils logiciels : le logiciel K-Réa v5 (Terrasol) permet d’analyser des écrans de soutènement en pente (parois moulées, pieux sécants, berlinoises, palplanches, etc.) avec la méthode des coefficients de réaction, en tenant compte du phasage et de la non-linéarité du sol. Il intègre également les vérifications ELU (modèles MEL, Kranz) pour les parois consoles tirantées. De plus, Talren peut être utilisé pour le calcul des diagrammes de poussée/butée dans les profils complexes (terres pleines, renforcement).
- Stabilité provisoire : on vérifie toujours la stabilité des fouilles et talus en cours de travaux (ex. F<1,3 pour l’état limite ultime provisoire). Des renforts temporaires (têtes de tirant supplémentaires, étais intérieurs) peuvent être ajoutés si besoin.
Modélisation avancée & “staged construction”
Pour les chantiers complexes, les outils de calcul aux éléments finis (PLAXIS 3D/2D notamment) sont très utiles :
- Phasage dynamique : avec PLAXIS, on peut modéliser l’exécution séquencée des travaux. En mode staged construction, on active ou désactive les sols, semelles, pieux et autres éléments structurels à chaque étape, reproduisant fidèlement les phases de creusement, de remblaiement et d’injection.
- Cas d’usage : on re-calibre ainsi les modules de sol (compaction, consolidation), on simule les déplacements transitoires et on intègre le couplage écoulement-déformation (étude de l’impact d’une nappe ou du drainage). Ce travail 3D/2D permet de comparer différentes variantes de phasage ou de renforcement et de les ajuster selon le retour d’instrumentation.
Méthode observationnelle (Eurocode 7) appliquée
La méthode observationnelle de l’Eurocode 7 encadre toute adaptation en temps réel :
- Avant chantier (planification) : définir les limites acceptables de performance (portance, tassements) et les scenarii possibles (“modèles de terrain” optimiste/pessimiste), établir le programme de suivi instrumenté et les actions contingentes à chaque seuil. Ces hypothèses et critères doivent figurer dans le dossier G3 de projet (voir page Rapport G3 – hypothèses révisables).
- Pendant le chantier (G3) : comparer régulièrement les mesures réelles aux prévisions G2. Si un seuil est dépassé, appliquer immédiatement les solutions préétablies (par exemple passer de semelles à micropieux, ajuster le niveau des tirants, etc.). Chaque révision est formalisée, tracée dans les notes de calcul et validée par la maîtrise d’œuvre.
Ainsi, le suivi G3 est un cycle mesure-réaction continu : on ajuste la conception selon un plan d’actions prédéfini, ce qui permet de piloter les variantes G3 de manière planifiée et sécurisée.
Organisation & traçabilité (RACI chantier)
La réactivité en G3 implique une organisation projet bien huilée :
- Responsabilités : définir clairement « qui décide quoi » entre MOA (maître d’ouvrage), MOE (maîtrise d’œuvre), entreprise et bureau d’études géotechniques. Idéalement, une boucle courte doit permettre à l’équipe chantier (MOE/entreprise) de proposer rapidement une variante G3 au MA (avec avis du BE géo) pour validation.
- Documents & suivi : la note de recalcul G3 fait office d’outil de décision : elle est soumise aux parties prenantes avant exécution. Tout changement d’implantation ou de méthode doit être consigné (journal de chantier, procès-verbal d’instruction, rapports d’arrêt). Le DOE/DIUO final intègre les modifications en cours d’exécution. Un RACI ou plan de communication peut formaliser ce circuit d’approbation pour chaque variante G3.
Impacts planning & coûts (piloter sans dérive)
Un recalcul G3 a des conséquences sur le planning et le budget, qu’il faut anticiper :
- Points d’arrêt : prévoir des jalons (notations sur les plans G2) où les observations déclenchent les recalculs G3. Par exemple, atteindre un niveau d’excavation critique ou la fin d’une phase de terrassement.
- Arbitrages coûts-risques : peser le coût immédiat de la solution (ex. plus de pieux, précautions supplémentaires) contre le risque de dérive ultérieure (tassements supérieurs, aléas de stabilité, retard). L’anticipation de variantes, même coûteuses, peut s’avérer moins onéreuse que des travaux imprévus à terme.
- Clés de succès : définir des pré-plans d’action valides avant travaux (grilles de décision avec seuils) afin d’éviter les négociations ad hoc sur le chantier. Plus la stratégie observationnelle est élaborée en amont, plus la gestion de la G3 sera fluide.
Encadré pratique : “arbres de décision” express
Pour chaque type d’ouvrage, on peut schématiser des voies de décision rapides :
- Fondations superficielles : si tassement ou portance limite dépassée → options : élargir semelle / passer en puits/micropieux / améliorer le sol (injections, compactage) / recourir à des inclusions rigides (pieusage sous radier). (Voir calculs associés dans FoxTA.)
- Pieux (fondations profondes) : si portance inatteinte ou flexion excessive → ajuster profondeur/diamètre / nombre de pieux / redistribution de charge; vérifier l’effet de groupe et le frottement négatif.
- Parois de soutènement : si déplacements ou pressions anormaux → ajouter tirants / butons / ajuster la profondeur des palplanches / modifier le phasage de fouille.
Chaque option renvoie au logiciel ou à l’étude correspondante (par exemple K-Réa pour les parois, FoxTA pour les fondations) et à la note G3 associée.
Voici un tableau de synthèse rassemblant les signaux G3, les risques, la démarche de recalcul, les outils/logiciels, les adaptations EXE et la traçabilité attendue.
| Catégorie | Signal d’alerte G3 | Risque principal (ELU/ELS/chantier) | Recalcul & vérifs clés (G3) | Outils / normes | Adaptations EXE possibles | Livrables & points d’arrêt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondations superficielles (semelles/radier) | Portance mesurée < prévue (CPT/PMT/plaques) ; tassements > seuil | ELU non tenu, tassements excessifs, différentiel | Recalage paramètres (φ, c, E) ; vérif portance/tassements ; interaction sol-structure | Foxta v4 (FONDSUP/TASPLAQ) ; EC7 ; NF P 94-261 | Élargir semelles/radier ; passer en puits/micropieux ; inclusions rigides ; amélioration de sol (injections, compactage) | Note de recalcul G3, plans EXE révisés (armatures, dimensions), seuils et points d’arrêt |
| Fondations profondes (pieux/barrettes) | Essais stat./dyn. ou CPT/PMT défavorables ; frottement négatif ; effet de groupe | Capacité insuffisante, tassements, flambement | Modèles q–z / t–z ; effet de groupe ; portance latérale/à la pointe ; tassements | Foxta v4 (FONDPROF) ; EC7 ; NF P 94-262 ; guide CEREMA | Augmenter profondeur/diamètre ; nombre de pieux ; redistribution ; traitement de sol | Note G3, plan de redistribution, protocole d’essais de contrôle, MAJ DOE/DIUO |
| Améliorations de sol / Inclusions rigides (ASIRI) | Tassements > seuil sur couches compressibles ; hétérogénéité forte | ELS (déformations, fissuration), service | Transfert de charge ; rigidité matelas ; taux de participation des inclusions | ASIRI / ASIRI+ ; Foxta ; PLAXIS (composite) | Densifier entraxes/longueurs d’inclusions ; renforcer matelas (géosynthétiques) ; injections | Fiche variante ASIRI, plans EXE (implantations), plan de monitoring des tassements |
| Parois / soutènements (moulées, palplanches, berlinoises) | Déplacements > seuil ; poussées > prévues ; nappe plus haute | Instabilité provisoire, impact avoisinants | Recalage poussées ; efforts dans paroi ; ancrages/butons ; stabilité provisoire | K-Réa v5 (phasage, non-linéarités) ; Talren (stabilité globale) ; EC7 | Ajouter tirants/butons ; augmenter profondeur d’encastrement ; modifier phasage ; drainage | Note G3, coupe EXE révisée (tirants, butons), points d’arrêt par phase |
| Terrassements / nappe / anti-flottabilité | Nappe plus haute ; venues d’eau ; soulèvement du radier | Renard, instabilité fouille, flottabilité | Vérif stabilité provisoire ; anti-flottabilité ; dépressions piézométriques | PLAXIS (couplage eau-déform.) ; K-Réa (phasage) ; règles chantier | Rabattement, drainage, radier lesté, pompes de secours, séquençage des passes | Plan de pompage, plan d’instrumentation, procédures d’alerte |
| Talus / stabilité globale | Inclinomètres en dérive ; fissuration de berme | Glissement, atteinte tiers | Cercle de rupture ; FOS ; renforcement | Talren ; recommandations clouage/drainage | Clouage, ancrages, banquettes, drainage, géosynthétiques | Note G3, plan EXE (clous/geo), jalons de contrôle |
| Modélisation avancée / phasage | Variantes multiples ; interactions complexes | Choix non optimisé, retard | Staged construction ; recalage modules ; scénarios | PLAXIS 2D/3D ; EC7 | Comparer variantes : ordre des phases, équipements temporaires | Mémo de choix technique + captures modèle ; versioning |
| Méthode observationnelle | Seuils dépassés (déplacements, pressions, niveaux d’eau) | Sous-dimensionnement, dérive planning | Application actions contingentes ; mise à jour seuils | EC7 – méthode observationnelle | Passer à variante prévue (ex. micropieux, tirants suppl.) | Fiches seuils/réactions, PV de décision, MAJ journal des modifs |
| Organisation & traçabilité (RACI) | Décisions tardives / non tracées | Risque contractuel, rework | Circuit d’approbation ; diffusion MOE/entreprise/MOA ; versioning | RACI projet ; journal de modifs ; DOE/DIUO | Boucle courte décisionnelle ; check-list diffusion | RACI, registre des versions, liste de diffusion, annexes au DOE |
Besoin d’un recalcul G3 ou d’une variante d’exécution ?
GEO2MO réalise des notes de calcul G3 et des plans d’exécution révisés partout en France, avec délais courts et appui chantier complet (points d’arrêt, monitoring, échanges MOE/entreprise).