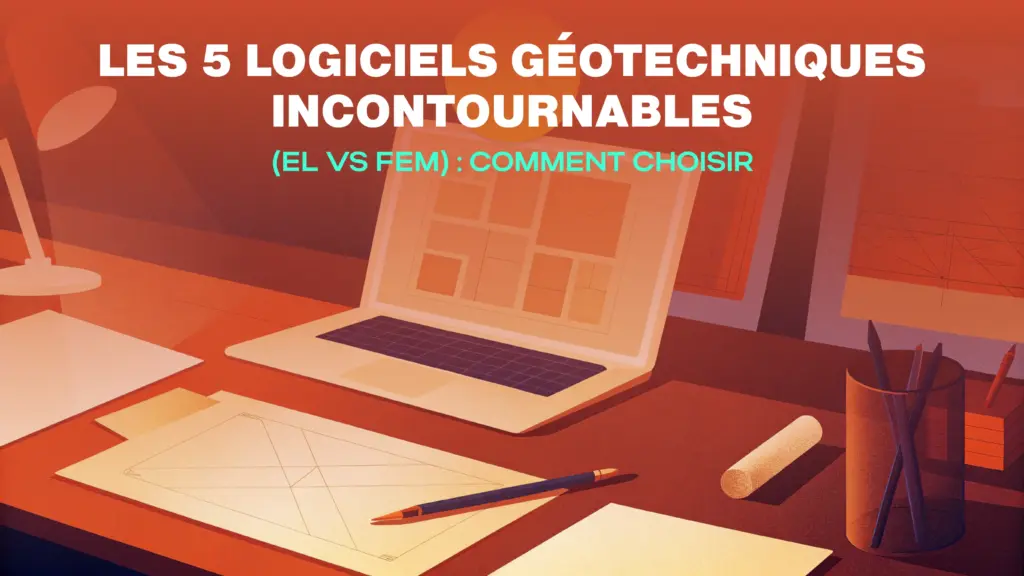Tableau récapitulatif : options “gratuites” et limites (France)
| Besoin | Option (exemples) | EL/FEM | Type de “gratuit” | Recommandé si… | À éviter si… |
|---|---|---|---|---|---|
| Stabilité de talus (FS) | Freeware talus (ex. HYRCAN) | EL | Gratuit total | pré‑dimensionnement / apprentissage | eau complexe, phasage, avoisinants sensibles |
| Portance / tassements EC7 | Calculateurs web + feuilles de calcul | EL | Gratuit total / open | ordre de grandeur + variantes | besoin de rapport “audit-ready” |
| Renforcement géosynthétiques | Outils éditeurs “free to use” (ex. Tensar+) | EL | Freemium cloud | cas cadrés, design rapide | hors périmètre produit / justificatif multi‑scénarios |
| Fondations/murs/pentes rapides | Apps cloud (ex. Rischio) | EL | Freemium (compte gratuit) | calculs rapides, itérations | exports/rapports limités, modules payants |
| FEM pour apprendre | FEM “freeware” (ex. ADONIS) | FEM | Gratuit total | comprendre maillage/CL | phasage réaliste + calibration avancée |
| FEM “industrie” | Versions LE / Student (PLAXIS, GeoStudio…) | FEM/EL | Licence étudiant | formation “proche BET” | usage commercial / modèles trop gros |
| Suite pro (production) | Logiciels commerciaux (PLAXIS, GeoStudio, Geo5…) | EL/FEM | Essai 15–30 j | trancher vite sur un cas réel | si vous n’avez pas les données prêtes |
À retenir : en France, un outil gratuit peut servir… mais vos hypothèses, paramètres et coefficients (Eurocode 7 / NF P 94‑500) doivent rester traçables et reproductibles.

Vous tapez logiciel géotechnique gratuit parce que vous voulez calculer vite, sans licence coûteuse. En pratique, le “gratuit” se décline en 5 familles : freeware, open‑source, freemium cloud, licences étudiant, essais 15–30 jours.
Objectif de cette page : vous aider à choisir le bon niveau d’outil (EL vs FEM) et à savoir quand passer au payant ou se faire accompagner.
Pour qui ?
- Étudiant / junior : apprendre les bons réflexes (données → hypothèses → validation), même avec une version limitée.
- BET géotechnique : sécuriser une note (ou une pré‑note) malgré un budget outil serré.
- MOE / entreprise : éviter de confondre “calcul rapide” et “justification acceptable” (et savoir quand demander une revue).
Quel “logiciel géotechnique gratuit” existe vraiment en 2026 ?
Le premier piège, c’est la définition : beaucoup de pages annoncent “gratuit” alors qu’il s’agit d’un freemium, d’une version étudiant, ou d’un essai. Pour bien trier, posez-vous 3 questions simples :
- 0€ : puis-je calculer sans payer sans échéance ?
- Livrable : puis-je produire une note exploitable (hypothèses, unités, coefficients, résultats) ?
- Reproductibilité : puis-je refaire le calcul plus tard (même version, mêmes options) ?
Gratuit total vs freemium vs essai vs étudiant : quelles différences ?
- Freeware : installation locale, gratuit durable. Très utile pour apprendre et faire des contre‑calculs.
- Open‑source : flexible, mais demande souvent plus de mise en place et de validation (et un “packaging” rapport à construire).
- Freemium cloud : rapide, mais exports/rapports et modules avancés peuvent être payants.
- Étudiant / LE : excellent pour se former, rarement suffisant pour “livrer” en BET.
- Trial : la meilleure façon d’évaluer un outil pro sur un cas concret (si vous arrivez préparé).
Quels sont les meilleurs logiciels gratuits pour la stabilité de talus ?
Si vous cherchez surtout un facteur de sécurité (FS), les outils EL “talus” sont souvent les plus rentables à 0€ :
- compréhension des mécanismes de rupture (surfaces critiques),
- comparaison d’hypothèses (drainé/non drainé, surcharge, niveau d’eau),
- pré‑dimensionnement et itérations rapides.
Bon réflexe BET : faites au moins deux scénarios : court terme (non drainé si pertinent) et long terme (drainé), puis encadrez l’effet de l’eau (niveau piézo haut/bas).
Quand un freeware suffit (FS) et quand devient‑il risqué ?
Un freeware suffit souvent si : géométrie simple, chargement simple, objectif “ordre de grandeur”.
Il devient risqué si :
- l’eau pilote le mécanisme (nappe fluctuante, drainage incertain),
- vous avez des phases (terrassement par étapes, excavation),
- des avoisinants imposent des critères de déplacement,
- vous devez justifier des actions sismiques (même en pseudo‑statique, il faut cadrer).
Dans ces cas, gardez l’EL pour cadrer, puis basculez vers FEM / outil pro / relecture.
Existe-t-il un logiciel FEM géotechnique gratuit utilisable en pratique ?
Oui, mais il faut distinguer apprendre et produire :
- Pour apprendre : un FEM gratuit peut suffire à comprendre maillage, conditions aux limites et interprétation.
- Pour produire : la difficulté est moins le calcul que la calibration, le phasage et la traçabilité (ce que vous présenterez à un relecteur).
FEM open-source vs outils “research” : que faut-il prévoir ?
En FEM, prévoyez du temps pour :
- choisir une loi de comportement cohérente avec vos essais (et accepter qu’un modèle “simple” soit parfois plus robuste),
- définir un domaine, un maillage et des conditions aux limites qui ne “biaisent” pas la réponse,
- régler les états initiaux (contraintes en place, K0) et les conditions de drainage,
- documenter des sensibilités (eau, paramètres, frontières).
Sans cela, le risque est un résultat “propre” mais non défendable.

Quels outils gratuits pour fondations, tassements et portance (Eurocode 7) ?
Beaucoup de besoins courants peuvent être adressés par un calcul EL bien structuré :
- portance / contraintes de contact,
- tassement (au moins en première approche),
- pré‑dimensionnement de semelles/radier simples (avec prudence),
- vérifications rapides en phase avant‑projet.
En France, gardez en tête la logique “dossier” : distinguer états limites ultimes (sécurité) et états limites de service (déformations), et expliquer vos choix de coefficients et d’approche de calcul plutôt que de les laisser “par défaut”.
Calculateurs web / feuilles de calcul : quels bons usages et quels pièges ?
Bons usages : ordre de grandeur, variantes, préparation d’un modèle plus riche, vérification croisée.
Pièges : coefficients appliqués sans lien avec votre contexte, unités/conventions, absence de rapport. En BET, construisez votre fiche hypothèses et archivez la version de l’outil/feuille utilisée.
Quelles versions étudiant gratuites pour apprendre Plaxis / GeoStudio ?
Les accès “Education/Student” sont souvent la voie la plus réaliste pour manipuler des workflows proches de la pratique :
- interface et résultats comparables à des suites pro,
- cas d’école (talus, excavation simple, interaction sol‑structure basique),
- progression rapide pour un junior.
Que permettent réellement les versions “LE / Student mode” ?
En général, elles limitent : taille du modèle, modules avancés, usage commercial et parfois exports.
Plan d’apprentissage efficace (sans se disperser) :
- un talus (FS + déplacements),
- une excavation (phasage),
- une interaction sol‑structure (mur, fondation).
Conclusion : très bien pour se former et prototyper, mais à encadrer sur un dossier réel.
Comment obtenir une version d’essai (trial) des logiciels pro (Plaxis, etc.) ?
Un trial est pertinent si vous avez un projet réel mais que vous hésitez à investir dans une licence. Le vrai test n’est pas “est-ce que ça s’installe ?” mais “est-ce que je peux produire un livrable”.
Que peut-on tester en 15–30 jours et comment s’organiser ?
- choisir 1 cas (ex. soutènement urbain) plutôt que “tout tester”,
- préparer données (stratigraphie, eau, paramètres, charges, phasage),
- définir sorties attendues (FS, déplacements, efforts, pressions),
- faire 2–3 sensibilités et une mini note interne.
Astuce : ne gaspillez pas la semaine 1 en installation. Bloquez tout de suite une fenêtre “modèle 0 → résultats” (même imparfaite), puis améliorez.
Quel outil gratuit choisir selon votre cas : talus, soutènement, excavation, tunnel ?
Cherchez le meilleur compromis entre temps, risque et livrable :
- Talus simple (FS) : freeware EL + contre‑calcul.
- Fondations simples : calculateurs EC7 + feuille structurée.
- Soutènements / parois : EL au pré‑dimensionnement, FEM dès que phasage/avoisinants dominent.
- Excavation urbaine / tunnel : FEM quasi incontournable.
Côté MOE/entreprise : si votre objectif est une estimation (variantes, budget, planning), un freemium peut suffire. Si votre objectif est une justification d’exécution, vous aurez besoin d’un workflow rapport/traçabilité (pro ou accompagné).
Besoin de dimensionner un ouvrage de soutènement ? Consultez Dimensionnement de soutènements et de parois.
Équilibre limite (EL) vs FEM : comment décider sans sur-modéliser ?
La bonne question : quel niveau de modèle répond à la question d’ingénierie ?
- EL : stabilité (FS), pré‑dimensionnement, contre‑calculs rapides, hypothèses lisibles.
- FEM : déplacements, interaction sol‑structure, phasage, lois de sol plus riches.
Déclencheurs typiques de FEM (même en 2D) :
- exigence de déplacement admissible (service),
- phasage de terrassement / soutènement provisoire,
- interaction (rigidité structure, interfaces),
- contrastes de rigidité (couches très différentes).
Règle pratique : démarrez en EL pour cadrer, puis passez en FEM quand la question devient “combien ça bouge, quand, et avec quelles phases”.
Quelles données minimales faut-il avant d’ouvrir un logiciel (gratuit ou non) ?

Un logiciel ne compense pas un manque de données. Avant de modéliser, verrouillez au minimum sol / eau / charges / phasage.
Avez-vous le check “sol / eau / charges / phasage” ?
| Bloc | Minimum “pratique” | À clarifier en priorité |
|---|---|---|
| Sol | stratigraphie + paramètres cohérents (plage) | domaine drainé/non drainé, dispersion |
| Eau | 1 scénario sec + 1 défavorable | ligne piézo, drainage, variations |
| Charges | cas principaux + combinaisons | zones de charge, surcharges, phases |
| Phasage | 2–3 phases clés | séquence, temps, conditions aux limites |
Pour cadrer les paramètres, basez-vous sur une campagne d’essais adaptée (ressource : Les essais géotechniques : in situ et labo).
Quelles erreurs fréquentes avec les logiciels gratuits (unités, drainage, paramètres) ?
Les erreurs “classiques” sont rarement liées au prix du logiciel :
- unités et conventions (kPa/MPa, kN/m, axes, signes),
- eau mal représentée (drainage imposé, ligne piézo incohérente),
- paramètres hors domaine (E trop élevé, cu utilisé à tort),
- frontières/maillage (FEM) : domaine trop petit, appuis trop rigides, maillage trop grossier près des singularités,
- états initiaux (FEM) : contraintes en place incohérentes, K0 non maîtrisé,
- interfaces : résistance interface “optimiste” et glissement sous‑estimé,
- interprétation : confondre stabilité (EL) et service (déplacements).
Mini test : faites varier un seul paramètre (ex. niveau d’eau). Si la tendance n’est pas logique, vous avez un problème de modèle.
Comment valider un résultat : règles d’ordre de grandeur + contre-calcul EL ?
Pour rendre vos résultats crédibles :
- vérifiez les ordres de grandeur (contraintes, tassements, pressions),
- faites un contre‑calcul EL même si votre étude est en FEM,
- testez 2–3 sensibilités (eau, paramètres, surcharge),
- reliez les résultats aux tolérances du projet (déplacements admissibles, voisinage),
- si possible : une relecture paire (même rapide) pour casser les biais.
Quels livrables sont attendus sur un dossier sérieux (traçabilité, rapport, hypothèses) ?
Sur un dossier “revu” (BET, MOE, bureau de contrôle), on attend :
- hypothèses (sol/eau/charges/phasage) + limites,
- origine des paramètres (essais, corrélations, prudences),
- méthode (EL/FEM, modèles, coefficients Eurocode 7),
- résultats exploitables (FS, déplacements, efforts, tassements),
- fichiers/exports permettant la reproductibilité.
Repère pratique : plus l’enjeu augmente, plus vous devez expliciter le raisonnement, pas seulement l’écran de résultats.
Si vous devez cadrer une mission, les pages internes Étude de sol obligatoire : loi ELAN et Bien comprendre une étude de sol G2 : AVP vs PRO peuvent aider à parler le même langage que les intervenants.
Quand passer au payant : quels signaux (complexité, phasage, avoisinants, 3D) ?
Envisagez du payant (ou une assistance) si vous cochez plusieurs points :
- enjeu élevé (avoisinants, sécurité, dommages),
- phasage ou consolidation/drainage,
- critères de déplacements/servitude,
- géométrie complexe ou besoin 3D,
- relecture externe nécessaire, ou délai très court,
- vous passez plus de temps à “rattraper” l’outil qu’à concevoir.
Combien coûtent les solutions pro et quelles alternatives si budget limité ?
La comparaison utile n’est pas seulement “prix licence”, mais temps + risque :
- coût d’apprentissage (formation, modèles types),
- coût d’itérations (sensibilités, variantes, phasage),
- coût de relecture (interne/externe) et de justification.
Pour recaler vos arbitrages côté études, voir Combien coûte une étude de sol ? (G1 à G5).
Achat licence vs prestation externe vs validation de modèle : que choisir ?
- Licence : si vous avez un volume récurrent + process interne.
- Prestation externe : si le besoin est ponctuel ou critique.
- Validation de modèle : si vous gardez votre outil (gratuit ou non) mais voulez sécuriser hypothèses, paramètres et cohérence (sans repartir de zéro).
Décision : outil gratuit, trial, ou accompagnement Geo2mo — que choisir ?
| Enjeu faible (pré‑étude) | Enjeu critique (avoisinants / sécurité) | |
|---|---|---|
| Complexité faible | Gratuit/freemium + contre‑calcul EL | Gratuit seulement avec validation renforcée + revue |
| Complexité élevée | Trial ou pro si récurrent | Pro + process + (souvent) relecture/accompagnement |
Ressources : quelles checklists et workflows utiliser en BET français ?
Pour gagner du temps (et éviter les oublis), gardez 3 routines :
- Fiche hypothèses (sol/eau/charges/phasage) + versionnage des fichiers.
- Double calcul : EL pour cadrer + FEM (si nécessaire) pour déplacement/phasage.
- Sensibilités minimales : eau + paramètres clés + frontière/maillage (en FEM).
Workflow court (exécutable en interne) :
- cadrer la question (stabilité ? déplacement ? interaction ?),
- fixer 2 scénarios d’eau,
- sortir un EL “cadre”,
- décider si FEM est nécessaire,
- produire une note lisible (hypothèses → calcul → validation → limites).

FAQ : “Plaxis gratuit ? GeoStudio gratuit ?” + “un logiciel remplace-t-il une étude de sol ?”
Un logiciel géotechnique gratuit est-il acceptable pour un bureau de contrôle ?
Parfois, si la méthode est adaptée et que votre dossier est traçable (hypothèses, paramètres, coefficients, sensibilités). Le frein principal est souvent le livrable “audit‑ready”, pas le calcul.
Plaxis est-il gratuit ?
On trouve des accès “étudiant/education” et des essais. Pour un usage BET, utilisez surtout l’essai pour évaluer le workflow, puis basculez vers une solution pro ou un accompagnement.
GeoStudio est-il gratuit ?
Il existe des modes “student” et des essais selon les offres. Vérifiez toujours les limitations (exports, modules, taille de modèle) avant de baser un dossier dessus.
Quelle différence entre EL et FEM pour un talus ?
EL donne surtout un FS et une surface critique. FEM ajoute les déformations et le phasage (au prix de plus de paramètres et de validation).
Puis-je faire une mission G2/G5 avec un outil gratuit ?
Un outil ne remplace pas les données, la compétence, ni les livrables attendus. Sur une mission G2/G5, la question est : pouvez‑vous produire un dossier défendable et reproductible ? Sinon, passez au pro ou faites valider.
Quelles données minimales pour éviter un modèle “joli mais faux” ?
Stratigraphie + paramètres cohérents, scénarios d’eau, charges/combinaisons, et phasage minimal. Sans ces quatre blocs, vous faites une simulation décorative, pas une justification.